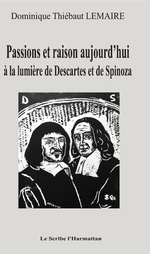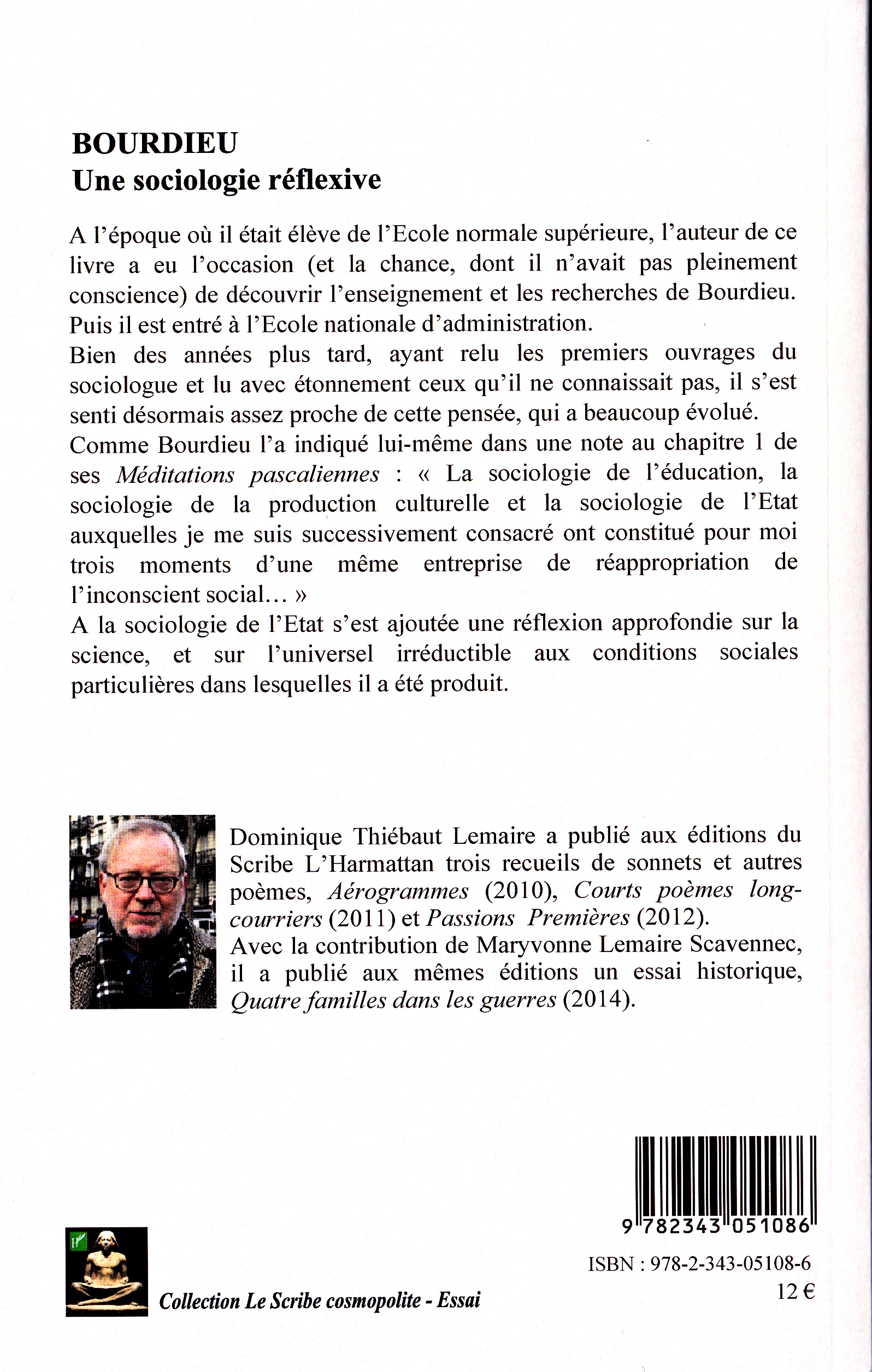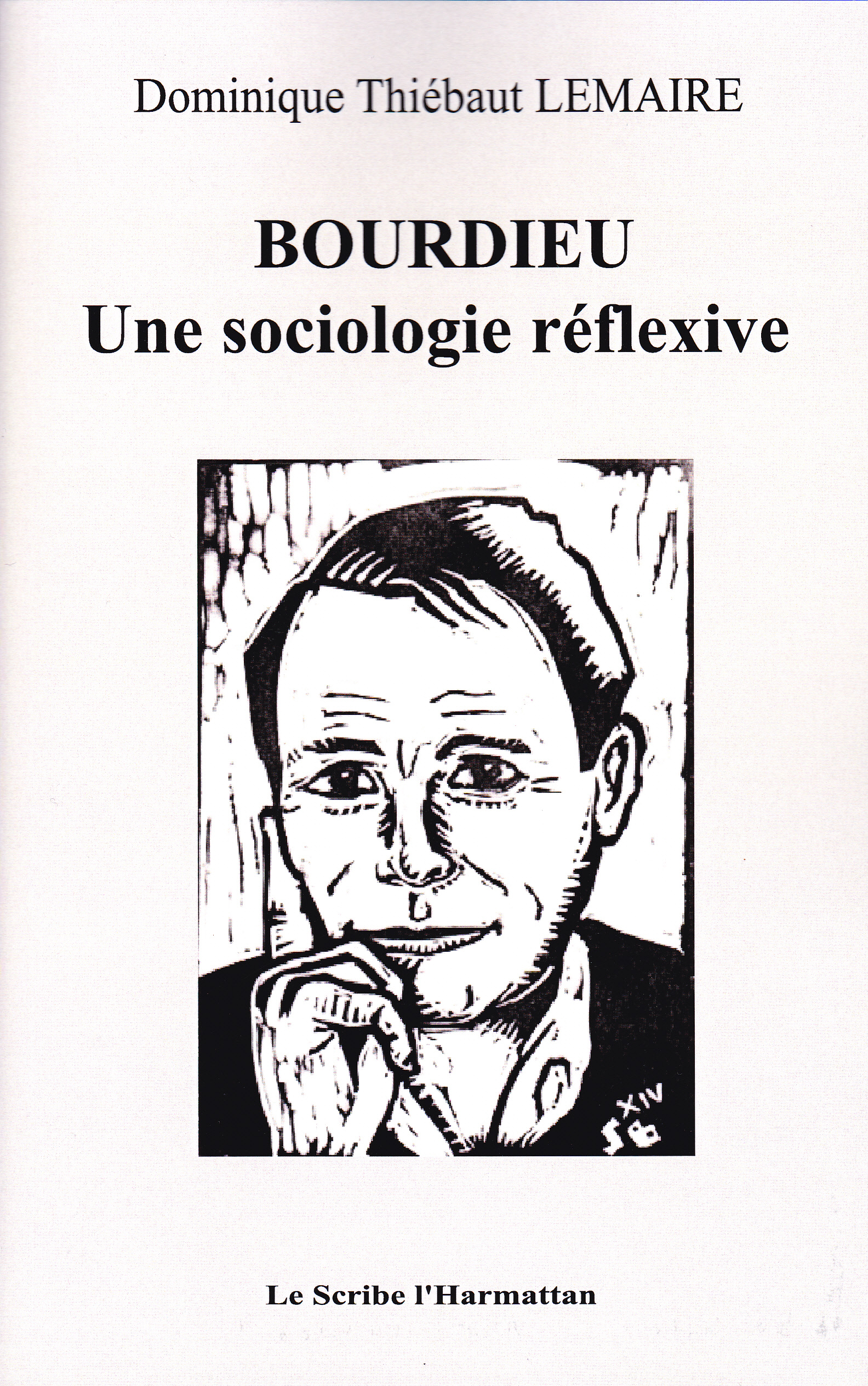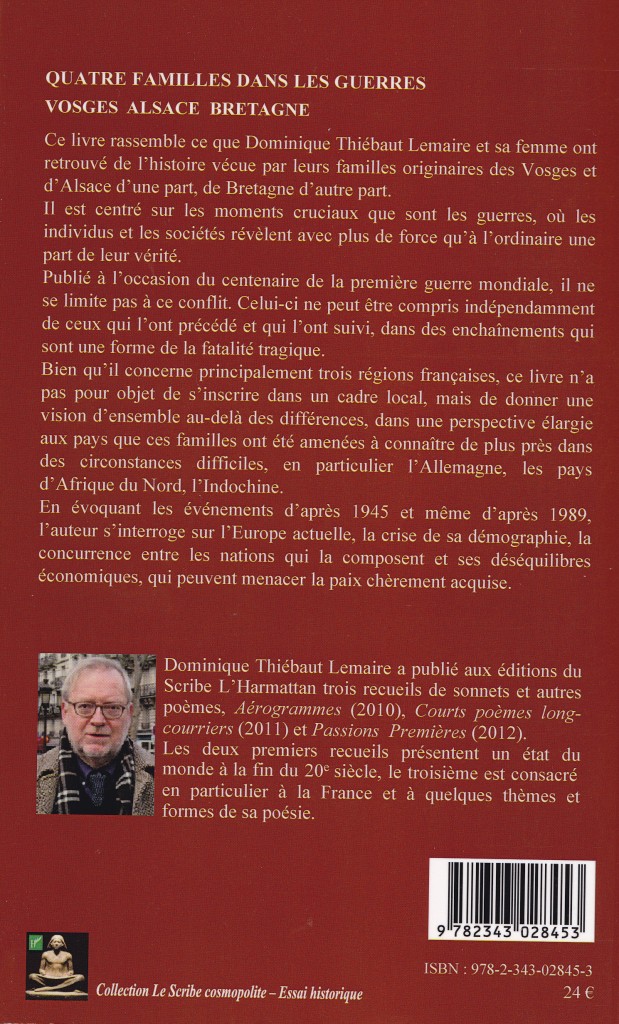Ce livre peut être commandé aux éditions L’Harmattan (voir le site internet de ces éditions) au prix de 22,80 euros TTC plus 3 euros de frais d’expédition : paiement sécurisé par carte bancaire, ou paiement par chèque à L’Harmattan , 16 rue des Ecoles, 75005 Paris.
COMMENT LIRE CE LIVRE
On peut le lire de manière linéaire ou de manière non linéaire, par exemple à partir de la table des matières qui donne le choix entre plusieurs entrées (une introduction, cinq chapitres dont un par famille et les annexes correspondantes). On peut l’aborder comme un recueil de nouvelles, en commençant par les chapitres que l’on veut, et les annexes que l’on veut, qui ne sont pas moins intéressantes que les chapitres.
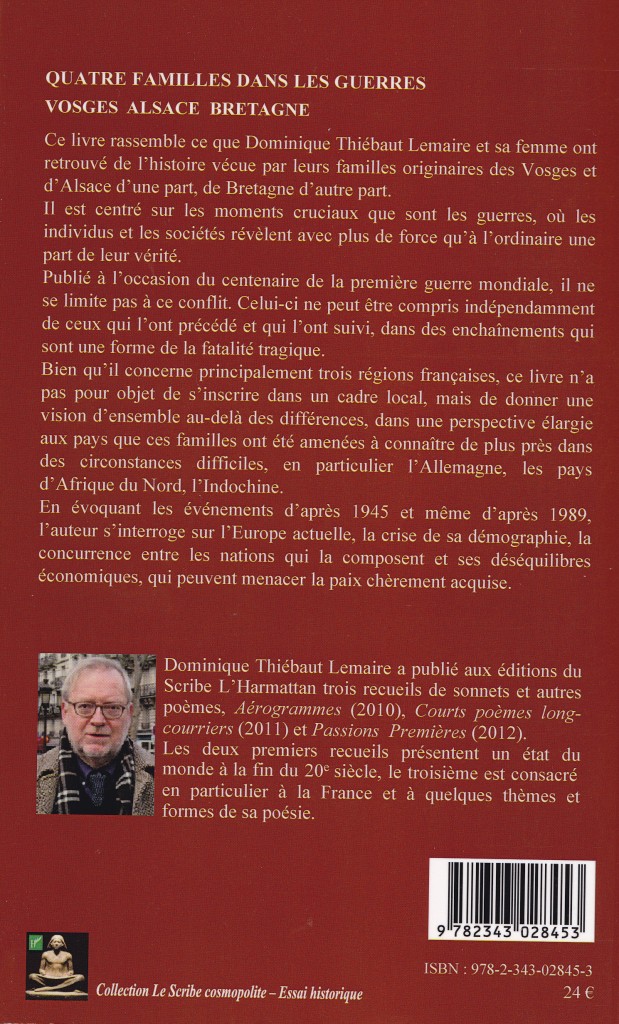
Des parties de l’ouvrage ont été publiées précédemment sur Libres Feuillets, sous la forme d’articles :
– Le 23 août 2012 : « Camille et Paul Claudel, leurs attaches vosgiennes » par Dominique Thiébaut Lemaire;
– Le 2 novembre 2012 : « Une famille vosgienne dans les guerres des 19e et 20e siècles » par Dominique Thiébaut Lemaire ;
– Le 10 novembre 2012 : « Une famille alsacienne dans les guerres des 19e et 20e siècles » par Dominique Thiébaut Lemaire ;
– Le 9 décembre 2012 : « Une famille bretonne, de la Révolution aux guerres du 20e siècle » par Dominique Thiébaut Lemaire ;
– Le 26 mai 2013 : « Petite Odyssée d’un marin breton, René Scavennec. I.1939-1943 ». Transcription et présentation par Maryvonne Lemaire Scavennec;
– Le 22 juin 2013 : « Petite Odyssée d’un marin breton, René Scavennec.II. 1943-1945 ». Transcription et présentation par Maryvonne Lemaire Scavennec ;
– Le 13 octobre 2013 : « La dénatalité en Europe : démographie et conflits » Par Dominique Thiébaut Lemaire;
– Le 5 mars 2014: » Petite Odyssée d’un marin breton, René Scavennec. III.1945-1957 « . Par Maryvonne Lemaire Scavennec.
DES SOURCES VARIEES
Le genre littéraire est indiqué sur la quatrième de couverture : « Essai historique ». Ce n’est pas une généalogie. Ce ne sont pas seulement des récits de vie. En plus de sauver de l’oubli ce qu’ils ont appris et ce qu’ils savent de leurs ascendants, les auteurs ont voulu articuler les destins individuels et familiaux avec la grande histoire.
Il s’agit d’une histoire non romancée, d’une « enquête » où ils ont cherché à reconstituer de plusieurs points de vue le passé de ces familles dans les guerres – et à en tirer des enseignements de portée plus générale – en recourant aux témoignages et documents divers, aux registres d’état civil, aux articles et ouvrages historiques, et même à la littérature.
Dans les annexes sont cités ou mentionnés des discours, des récits transcrits par écrit, des lettres, et même, pour la période la plus récente, quelques poèmes servant de témoignages (annexe 5.1).
La multiplicité des sources permet d’appréhender le sujet sous plusieurs angles, comme dans un portrait où le visage serait vu à la fois de face, de biais et de profil.
La disponibilité de nombreuses données informatisées, généalogiques et autres, donne aujourd’hui la possibilité de faire plus aisément le lien entre les générations, et de mieux enclencher le processus rattachant à l’histoire ce qui a été vécu, processus que l’on pourrait définir, même dans le cas des événements violents tels que les guerres, comme la pacification du souvenir.
Malgré la disparition de ceux qui ont vécu ces événements, il reste la transmission entre les générations, et il reste l’histoire, celle des historiens et de tous ceux qui veulent tendre à l’objectivité.
LES GUERRES
De la Révolution de 1789 jusqu’à nos jours, ce livre est centré sur les moments cruciaux que sont les guerres, où les individus et les sociétés révèlent avec plus de force qu’à l’ordinaire une part de leur vérité. Publié à l’occasion du centenaire de 1914, il ne se limite pas à ce conflit. Celui-ci ne peut être compris indépendamment de ceux qui l’ont précédé et qui l’ont suivi, dans les enchaînements d’une fatalité tragique.
Les guerres européennes dans lesquelles la population française a été impliquée aux XIXe et XXe siècles, en particulier celles de 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945, ont laissé des traces profondes, même si l’on dit que c’est du passé.
Nés à la fin des années 1940 au début de « l’après-guerre », les auteurs ont été confrontés, enfants, aux suites des guerres franco-allemandes dont le souvenir est resté présent dans les familles de leur ascendance, originaires de l’est et de l’ouest de la France. La proximité des lignes de front, le déroulement des combats sur le territoire français et les annexions de l’Alsace par l’Allemagne ont marqué l’est (et le nord) de manière plus proche, mais les mobilisations et les morts ont touché durement l’ensemble du territoire.
A vrai dire, ces guerres ne sont pas devenues tout à fait de l’histoire. Du côté français, la défaite de 1940 est encore douloureuse. Il suffit, pour s’en convaincre, de constater les manifestations du sentiment d’infériorité qui, au début des années 2010, s’exprime à nouveau dans les médias français face aux succès économiques allemands, bien que ceux-ci reposent sur des bases fragiles.
LES LIEUX DES QUATRE FAMILLES
Les familles dont il est question (définies par leur patronyme : Lemaire, Hillenweck, Rivier, Scavennec), auxquelles sont consacrés les quatre premiers chapitres de l’ouvrage, ont vécu les mêmes événements nationaux, avec quelques nuances, deux d’entre elles dans les Vosges et en Alsace, et deux en Bretagne : ce sont, d’un côté, à La Bresse dans les Vosges lorraines et à Thann en Alsace, les ascendants paternels et maternels de l’auteur, de l’autre côté, en Bretagne dans le Finistère, principalement à Rosporden, les ascendants paternels et maternels de sa femme.
La guerre de 1914-1918 a fait se rencontrer des hommes de diverses provinces et leur a fait connaître des régions qui n’étaient pas les leurs. Le peintre d’origine bretonne Mathurin Méheut (Lamballe 1882-Paris 1958) a été incorporé en 1914 au 136e RI à Arras dont il a représenté les destructions. Il a connu le front (Artois, Somme, Champagne, Meuse…), puis il a été affecté à partir de 1916 au service topographique et cartographique en raison de ses talents d’observateur. Il a réalisé de nombreux croquis de guerre qu’il appelait des « croquetons » et qu’il envoyait chaque jour à sa femme et à sa fille (voir au sujet de Méheut l’article de Libres Feuillets écrit par Maryvonne Lemaire, daté du 5 août 2013).
Fin septembre 1918, la 151e division d’infanterie dont faisait partie le régiment d’infanterie d’Eugène Lemaire (grand-père de Dominique Thiébaut Lemaire), a pris d’assaut, avec l’aide des chars, les redoutables lignes allemandes de la zone de Souain-Perthes-lès-Hurlus dans la Marne (Quatre familles dans les guerres, p.55).
C’est dans cette même zone de combats qu’ont été réunis dans la mort en 1915 plusieurs personnes de Quatre familles dans les guerres : le Breton Joseph Kerhervé à Perthes-lès-Hurlus (p.121), soldat au 31e régiment territorial d’infanterie; le Breton Louis Rivière à Perthes-lès-Hurlus également (p.116), caporal au 116e régiment d’infanterie; le Breton Vincent Charles Rivier (p.119), soldat au 127e régiment d’infanterie, au Mesnil-lès-Hurlus, village anéanti par les combats, où est mort aussi pour la France (p.25 et p.169) l’Alsacien Daniel Scheurer, de la famille des industriels imprimeurs de tissus à Thann.
Les ruines de l’église de Souain sont représentées dans l’un des tableaux de guerre du peintre et graveur Félix Vallotton, auquel une exposition a été consacrée à Paris au Grand Palais du 2 octobre 2013 au 20 janvier 2014. Comment évoquer la guerre ? Vallotton s’est interrogé sur cette question. Il écrit en 1917 : « D’ores et déjà je ne crois plus aux croquis saignants, à la peinture véridique, aux choses vues, ni même vécues. C’est de la méditation seule que peut sortir la synthèse indispensable à de telles évocations ». Cela dit, si Vallotton a vu et représenté la guerre et ses ravages, il ne l’a pas vécue comme combattant, au contraire de Méheut.
Des témoignages sur Thann en 1914-1918 (Quatre familles dans les guerres, p.26-27) ont été laissés par des artistes originaires de cette ville. Le milieu des dessinateurs industriels qui élaboraient les modèles pour l’impression sur étoffes a produit plusieurs créateurs dont certains sont connus, tels le peintre « nabi » Filiger (Thann 1863-Plougastel 1928) et Charles Walch (Thann 1896-Paris 1948). Moins connu, Robert Kammerer (1882-1965) élève de l’École de dessin industriel de Mulhouse, puis de l’École des Arts décoratifs de Strasbourg, peintre des Vosges, mérite mieux que l’oubli où il se trouve actuellement.
En 1937, Charles Walch a commencé à recevoir des récompenses (médaille d’or de l’Exposition universelle de Paris) et à vivre de son art. Il est très affecté par la débâcle de 1940. Son début de notoriété attire à lui d’autres peintres (Georges Rouault, François Desnoyer, Jean Bazaine, Marcel Gromaire). A partir de 1942, il joue un rôle important au Salon d’automne. Il réalise à la gouache un coq flamboyant qui sert d’affiche pour ce salon en 1945 et qui est considéré comme un symbole de la victoire sur l’Allemagne.
RECITS ET PORTRAITS
Quatre familles dans les guerres abonde en esquisses de récits et portraits mettant en scène divers personnages. Le sujet même de la guerre et les généalogies familiales fondées sur les patronymes placent au premier plan les hommes plutôt que les femmes. Pourtant, de beaux portraits de femmes se dessinent aussi dans ce texte.
Les temps de paix
Parmi les personnages, on trouve en particulier:
– un Rivier qui habitait au début du 18e au « Manoir de la Rivière » au bord de l’Aven, qui a habité ensuite en des lieux où affleure une nappe phréatique, et qui est mort noyé dans un étang de la partie amont de l’Aven (annexe 4.1) ;
– une famille d’agriculteurs qui a « dépecé » le château de Rustéphan à l’abandon près de Pont-Aven dans le Finistère (p.90) ;
– Les maçons d’une entreprise de bâtiment qui se sont vengés d’un client en s’arrangeant pour que la cheminée refoule la fumée dans la pièce (p.113) ;
– la patronne de la même entreprise, qui avait l’habitude de tricoter en allant visiter ses chantiers (p.113) ;
– Plusieurs personnes prises ou impliquées dans le conflit entre l’Eglise et l’Etat : mères de famille, instituteurs, joueurs de football, industriels (p.42-44, et annexe 1.2) ;
– le fonctionnaire français (l’auteur) négociateur d’un traité à Berlin Est juste avant l’effondrement de l’Allemagne de l’Est qui croyait pouvoir survivre à l’effondrement de l’URSS (p.149-150).
Les temps de guerre
Sous cette rubrique, on peut mentionner :
– l’administrateur du Finistère (conseiller général), ascendant des Rivier actuels, guillotiné avec ses collègues « girondins » en 1794 (à un moment où la France était en guerre contre toute l’Europe monarchique) pour avoir « attenté à l’indivisibilité de la République » (p.109);
– le maire de La Bresse qui s’est caché plus de 15 jours sous le foin épais de sa grange pour échapper aux recherches de l’autorité d’occupation allemande après la guerre de 1870-1871 ( p. 50);
– le jeune alsacien choqué par l’arrivée en 1870 des cavaliers prussiens qui se servaient en détachant avec leur lance les chapelets de saucisses à l’étal de la boucherie (p.76);
– l’engagé volontaire alsacien dont l’entourage a été exterminé par un obus à la fin de 1915 sur le front de Belgique, et qui a été nommé caporal en remplacement de l’un des tués (annexe 2.2 p. 217) avant de monter en grade ; son frère tué en Indochine en 1917 ;
– la mère de famille bretonne dont le mari est sous les drapeaux et qui, en plus de la ferme familiale, s’occupe de la ferme de son frère mort pour la France, dont elle a recueilli la fille (p.94) ;
– le Vosgien dont le fils a été fusillé par les Allemands, et qui parlemente en allemand avec l’armée d’occupation pour sauver de la destruction un quartier de la commune (p.57-58) ;
– les deux jeunes sœurs bretonnes portant au chef de la Résistance locale, en 1944, un message ou des brassards de FFI cachés dans leur pot à lait (p.122).
LES COMBATTANTS
Dans la famille Lemaire (chapitre premier), trois générations ont fait successivement les guerres de 1870-1871, 1914-1918, 1939-1945. Fils de Constant Lemaire – blessé en 1870-1871 et pensionné pour invalidité – Eugène Lemaire, père de plusieurs enfants, envoyé au front, a traversé la guerre de 1914-1918 sans blessure. L’un de ses fils, sous-lieutenant d’artillerie, décoré de la croix de guerre, a été fait prisonnier par un char allemand en mai 1940 alors qu’il se trouvait dans une jeep sur le front, et il est resté cinq ans dans un camp en Poméranie, tandis que l’autre, adjudant des chasseurs alpins, maquisard, décoré de la légion d’honneur à titre posthume, a été fusillé par les Allemands en 1944. A la fin de la même année, Eugène Lemaire, expulsé d’Alsace-Moselle avec sa famille en 1940, a participé activement au sauvetage de la population de la commune de La Bresse dans les Vosges.
Dans la famille Hillenweck (chapitre deux), Jean Hillenweck, encore enfant, a gardé un souvenir pénible et indélébile de l’arrivée des Prussiens en Alsace en 1870-1871. Deux de ses fils, bien que de nationalité allemande en 1914, se sont engagés dans l’armée française, et ont été envoyés en Indochine où l’un d’eux a trouvé la mort et a été décoré de la médaille militaire à titre posthume. Celui qui a survécu, décoré de la croix de guerre, a fait aussi la guerre de 1940 comme sous-lieutenant et a été expulsé d’Alsace par les Allemands. Le troisième fils, resté en Alsace, a été fait officier de la légion d’honneur pour ses actes de résistance en 1940-1944.
Dans la famille Scavennec (chapitre trois), René Scavennec, officier marinier, chevalier de la légion d’honneur, a vécu une petite odyssée d’une rive à l’autre de la Méditerranée de 1940 à 1943, entre la France, le Maroc, l’Algérie la Tunisie et l’Italie avant de pouvoir regagner la Bretagne où il a participé aux combats de la Libération à l’est et au sud de Quimper en 1944. Il a notamment entravé à Rosporden la retraite d’un convoi allemand qui, au début d’août 1944, se repliait vers le port de Lorient, en lui causant de lourdes pertes.
Dans la famille Rivier (chapitre quatre), le jeune ingénieur Albert Rivier, soutenu par sa famille et en particulier par son père François Rivier, entrepreneur, ancien combattant grièvement blessé pendant la guerre de 1914-1918, a été, de même que René Scavennec, l’un des chefs du maquis de Rosporden en 1944 en liaison avec Londres. Président de la délégation spéciale de Rosporden en 1944-1945 (autorité dirigeante de la commune à la Libération avant les élections municipales), il a été fait par la suite chevalier de la légion d’honneur.
L’ILLUSTRATION DE LA COUVERTURE
La gravure de Sergio Birga met en scène deux paysages symboliques réunis par les deux personnages du centre : à droite la collégiale de Thann, avec la « tour des sorcières », et un sapin ; à gauche, l’église de Rosporden avec un chêne. Au premier plan, de l’eau, plutôt celle des rivières, la Moselotte à La Bresse, la Thur à Thann et l’Aven à Rosporden, mais peut-être aussi celle de la mer où aboutissent les rivières. Les projecteurs de la DCA dans le ciel donnent un dynamisme particulier à l’image.
Sergio Birga, très influencé par l’Expressionnisme, a fait trois séjours en Allemagne (en 1965, 1966, 1976) pour y rencontrer plusieurs protagonistes de ce mouvement, plus particulièrement, Otto Dix et Conrad Felix Müller qui lui ont prodigué leurs conseils et qui ont échangé avec lui des portraits.
Otto Dix (1891-1969) s’est engagé comme volontaire en 1914, et a participé à plusieurs campagnes en Champagne, dans la Somme et en Russie. L’une de ses œuvres témoignant le plus fortement de ses expériences guerrières est le portefeuille de cinquante eaux-fortes, « Der Krieg », publié en 1924. Enseignant les beaux-arts à l’université de Dresde, il perd ce poste après la prise du pouvoir par les nazis en 1933, étant considéré par eux comme un «bolchévique de la culture ». En 1937, ses œuvres sont déclarées « dégénérées ». Beaucoup d’entre elles sont retirées des musées et une partie est brûlée ; d’autres sont exposées lors de l’exposition nazie « Entartete Kunst » (Art dégénéré). Il doit servir sur le front occidental en 1944-1945, et il est fait prisonnier en Alsace par les Français.
ANNEXE : LES ECRIVAINS EVOQUES DANS CE LIVRE
Il s’agit d’écrivains :
– qui ont connu les lieux où ces quatre familles ont vécu,
– et qui, pour certains, ont connu ces familles elles-mêmes.
Montaigne à Thann en 1580 (p.22-23)
En 1580, Montaigne entreprend un long voyage vers l’Italie, pour soigner dans diverses stations thermales sa gravelle (coliques néphrétiques) ; et pour s’éloigner des guerres de religion en France.
Il s’est arrêté pendant 11 jours aux eaux de Plombières près de Remiremont. A Remiremont, les chanoinesses, en conflit avec le duc de Lorraine qui voulait mettre fin à leur indépendance, ont demandé à Montaigne de plaider leur cause à Rome, le Saint-Siège les ayant constamment soutenues dans le passé. Mais, cette fois, Rome a tranché en faveur du duc, et le siège abbatial est devenu le monopole de la maison de Lorraine. En route vers Rome, Montaigne est passé à Thann dont le vignoble lui a inspiré des appréciations élogieuses :
« Tane…ville d’Allemagne, sujette à l’Empereur, très belle. Lendemain au matin, trouvâmes une belle et grande plaine flanquée à main gauche de coteaux pleins de vignes, les plus belles et les mieux cultivées, et en telle étendue, que les Gascons qui étaient là disaient n’en avoir jamais vu tant de suite. »
Chateaubriand et les chanoinesses de Remiremont (p.7-8), à la veille de la Révolution
Deux siècles après Montaigne, le chapitre de Remiremont a été un enjeu pour la famille de Châteaubriand. De ce Chapitre dépendait en grande partie la vallée de La Bresse.
La sœur préférée de Chateaubriand, Lucile, a essayé sans succès d’y devenir chanoinesse.
Sous l’Ancien Régime, ce genre d’institution, sorte d’abbaye mondaine, accueillait les filles nobles qui y étaient assurées d’un revenu et d’un statut social élevé. Pour y être admises, elles devaient faire la preuve de leurs quartiers de noblesse. Les Chateaubriand, en dépit de leurs grandes prétentions nobiliaires, n’ont pu remplir les conditions exigées à Remiremont, car il leur manquait des quartiers de noblesse du côté des ascendances féminines. Ces chanoinesses, qui habitaient en ville (d’où la beauté des maisons qu’on y trouve encore aujourd’hui), étaient libres de renoncer à leur condition pour se marier.
Hersart de la Villemarqué, le Barzaz Breiz et la famille Scavennec (p.91 et annexe 3.2)
Dans la famille des Scavennec, parmi les personnes apparentées, les chercheurs ont identifié des informateurs de Théodore Hersart de la Villemarqué, grâce auxquels celui-ci a composé son Barzaz Breiz, recueil de poèmes bretons chantés, traduits en français, annotés et publiés par lui au XIXe siècle. La résidence familiale de l’auteur du Barzaz Breiz, ancien élève de l’Ecole des chartes, se trouvait à Nizon (aujourd’hui Pont-Aven).
D’après les notes laissées par la mère de La Villemarqué sur les informateurs de son fils, des ascendants des Scavennec actuels lui ont chanté « Héloïse et Abailard », et « La Croix du chemin ».
« Héloïse et Abailard » montre une Héloïse si savante qu’elle ne peut être qu’une sorcière.
« La Croix du chemin » met en scène un jeune homme renonçant à la prêtrise pour l’amour de celle qu’il aime, un thème naguère encore bien vivace.
Pierre Loti et Rosporden (p.37-38)
Julien Viaud (Rochefort 1850-Hendaye 1923), officier de marine, alias Pierre Loti, écrivain, qui s’est inspiré de ses voyages, a tiré parti, dans certaines de ses œuvres, de la connaissance qu’il avait de régions françaises telles que la Bretagne. Rosporden est le lieu auquel se rattache l’histoire de Mon frère Yves (1883), un ami marin qui s’appelait en réalité Pierre Le Cor. Celui-ci s’est marié à Rosporden avec une native du lieu. Il a fait construire à Rosporden une maison dont Loti a rédigé lui-même le descriptif. Passé premier maître en 1886 grâce aux relations de Loti, Pierre Le Cor a quitté la marine en 1892. Il s’est retiré à Rosporden en ayant tendance à oublier ses bonnes résolutions de tempérance.
L’écrivain ne laisse pas de doute sur le fait qu’il s’agit de Rosporden. Il évoque la flèche en granit de l’église au bord des étangs formés par l’Aven. Il évoque aussi les fêtes religieuses et paysannes, les pardons, tels que celui de Bonne-Nouvelle, ainsi que celui de Saint-Eloi, où venaient les chevaux à l’occasion d’une messe basse qu’on disait là pour eux.
La région de Thann vue par Henry Bordeaux (p.27-29)
En 1914-1918, plusieurs personnalités sont venues à Thann, le principal territoire alsacien reconquis dès le début de la guerre. L’un de ces visiteurs, le romancier Henry Bordeaux (élu à l’Académie française en 1919) a publié après la guerre La Jolie fille de Thann, qui évoque cette ville et les combats très meurtriers du «Vieil Armand », zone montagneuse près de Thann au-dessus de la plaine d’Alsace.
Propriétaire à Chapareillan près de Grenoble, la mère d’André Bermance, jeune officier tué au Vieil Armand le jour de Noël 1915, a été invitée par la fiancée alsacienne de son fils, Maria Ritzen, fille d’un ingénieur travaillant chez M. Helding, riche industriel de Thann. D’après ce que dit de lui le romancier, M.Helding est Jules Scheurer, imprimeur sur étoffes, dont les fils sont morts pour la France en 1915. Henry Bordeaux décrit Thann par les yeux de Mme Bermance :
« Elle connut Thann, si jolie au débouché de la vallée, à l’entrée de la plaine, au bord de la Thur, effilant, entre les derniers contreforts arrondis des Vosges, la flèche ajourée de Saint-Thiébaut qui se dresse en l’air si aiguë, si mince, si délicatement ouvragée qu’elle semble appeler les rayons du soleil pour les sertir dans ses pierres comme des diamants. Elle aima ses rues propres et étroites, … son aspect ouvert et aimable jusque dans les ruines, ses vieilles maisons aux toits pointus… »
Roger Martin du Gard et l’été 1914 en Alsace (p.27)
Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature en 1937, termine la partie intitulée L’Eté 1914 de son roman Les Thibault par la mort de Jacques, l’un des deux fils Thibault, dans la région de Thann-Altkirch où s’est écrasé l’avion du haut duquel il voulait jeter des tracts pacifistes. Après l’accident, le blessé a entendu une discussion entre militaires français :
« On devait atteindre Thann, faire un mouvement de conversion, comme ça, un redressement le long du Rhin, pour aller couper les ponts. Mais on s’est trop pressé. On était mal engagé, tu comprends ? On avait voulu aller trop vite… Il a bien fallu battre en retraite…»
Finalement, Jacques Thibault, laissé en arrière dans la retraite précipitée des troupes françaises, est abattu par le gendarme qui le gardait et qui voulait fuir sans s’embarrasser de cet homme mal en point considéré comme un espion.
Stephan Zweig en Alsace entre les deux guerres mondiales (p.29)
Un récit de Stephan Zweig, dont Quatre familles dans les guerres donne les références, commence par la cathédrale de Strasbourg, et se poursuit par Colmar, où l’auteur admire le retable d’Issenheim, avant de se rendre chez Albert Schweitzer qui lui joue à l’orgue une cantate de Bach.
« Sur les flancs des Vosges et sur l’autre versant, le côté allemand où, d’heure en heure, les canons crachaient dans un bruit sourd leurs projectiles toxiques, une lumière vespérale s’étend, paisible, écrit Stephan Zweig. On peut marcher en toute insouciance sur la route qui, il y a quatorze ans encore, n’était plus qu’un tunnel recouvert de paille.
« Une journée aussi achevée permet de retrouver la foi face à l’époque la plus hostile. Mais le train poursuit sa course à travers la terre d’Alsace et voilà que soudain on sursaute, car les noms des gares criés au-dehors éveillent des souvenirs oppressants : Sélestat, Mulhouse, Thann. Ils sont restés dans nos mémoires à travers les bulletins de l’armée : ici 10 000 morts, là 15 000, et là-bas dans les Vosges, dont la silhouette argentée évoque des fantômes errant dans les brumes, 100 000 ou 150 000, tombés sous les baïonnettes, sous les balles, gazés, empoisonnés, victimes d’une haine, d’une guerre fratricides. Et on se reprend à désespérer, incapable de comprendre pourquoi cette même humanité qui produit les chefs-d’œuvre les plus étonnants, les plus inconcevables dans le domaine spirituel, n’a pas appris depuis tant de milliers d’années à maîtriser le secret le plus simple : maintenir vivant l’esprit d’entente entre les hommes de tous horizons qui ont en commun d’aussi impérissables richesses ».
Camille et Paul Claudel, à La Bresse et dans les Vosges (annexe 1.5, p.199-208)
Dans une lettre du 6 décembre 1946, adressée à Eugène Lemaire maire de La Bresse détruite, Paul Claudel écrit ceci :
« Non, Monsieur Le Maire, je n’oublie pas La Bresse ! Comment l’oublierais-je, la chère petite cité de qui le nom de Claudel est inséparable depuis je ne sais combien de générations ? N’est-ce pas sur un de vos registres paroissiaux qu’un chercheur a retrouvé le nom du patriarche Jacques Elophe Claudel, décédé en 1530, et de qui sont issus ou à qui se rattachent presque toutes les familles de la belle vallée ? C’est là qu’au début du siècle dernier, ma courageuse aïeule, restée veuve à la suite du décès accidentel de son mari, éleva une famille de six enfants.
« Mon père, Louis Prosper Claudel, conservateur des hypothèques, n’oublia jamais sa petite patrie, et chaque fois que les vacances le lui permettaient, il emmenait sa famille au cimetière où notre nom se répétait aussi souvent sur les tombes que sur les enseignes de la localité… »
Paul Claudel et Eugène Lemaire grand-père paternel de Dominique Thiébaut Lemaire étaient apparentés, issus l’un comme l’autre de mariages qui ont eu lieu en 1726 et 1758.
D’après des souvenirs de Paul Claudel, ses soeurs et lui ont passé des vacances d’été vers 1875-1880 à La Bresse, où ils cueillaient des brimbelles (nom vosgien des myrtilles) et se baignaient dans le Lac des Corbeaux. Camille Claudel, en août 1885, a passé ses vacances à Gérardmer chez son oncle Isidore, Gegout, mari de Joséphine Claudel. A cette occasion, elle a dessiné au fusain une « femme de Gérardmer » qui se trouve aujourd’hui au musée Eugène Boudin à Honfleur.
Libres Feuillets