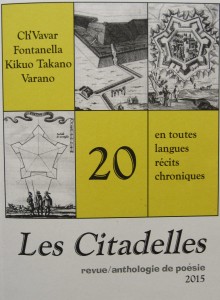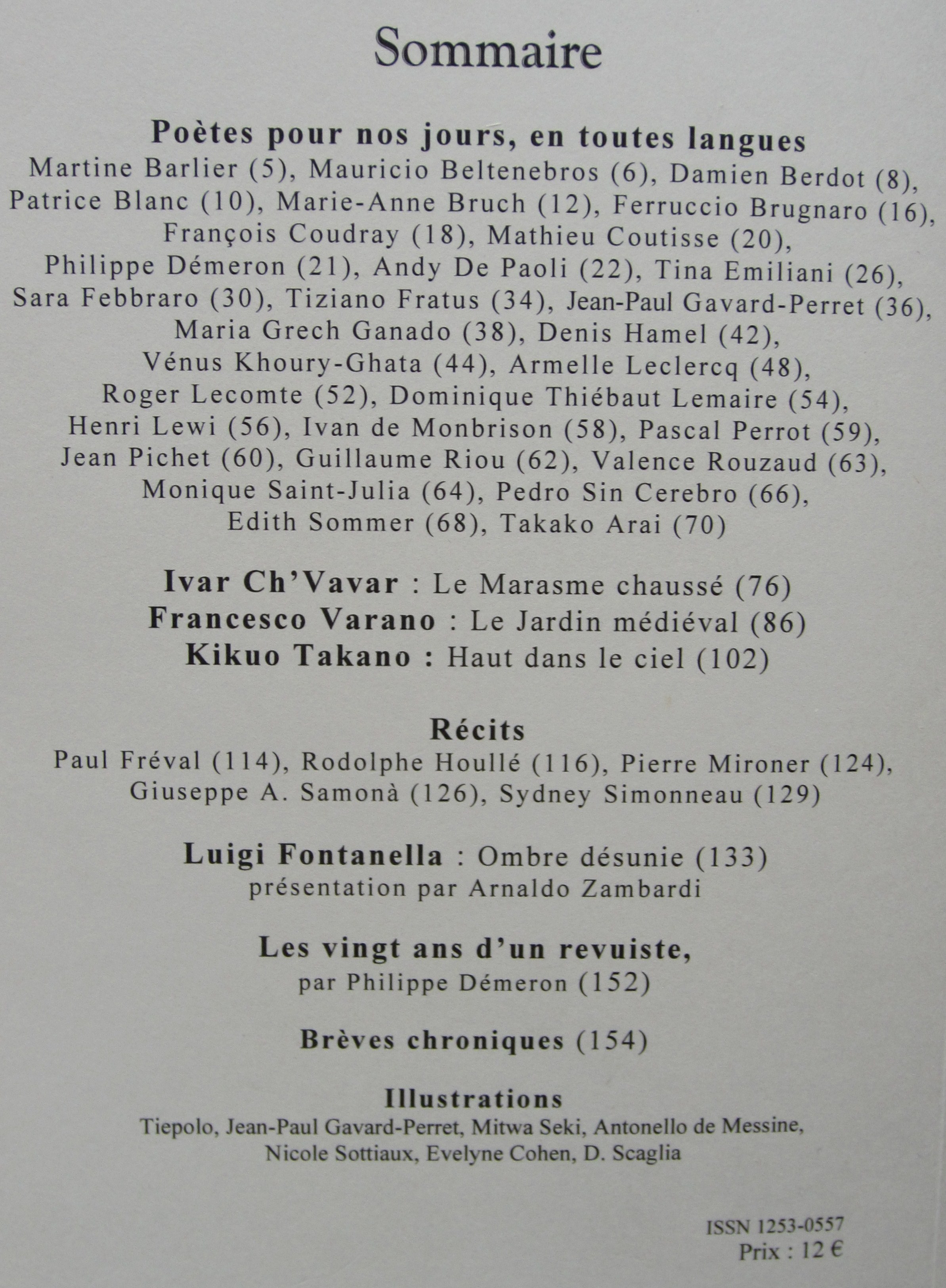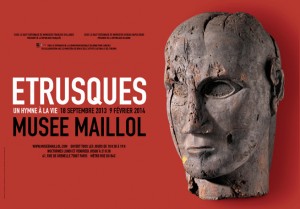Les Vosges dont Camille et Paul Claudel sont originaires du côté paternel, et où ils ont passé de nombreuses vacances dans leur enfance et leur jeunesse, ont été pour eux une source d’inspiration peu visible mais certaine.
Ainsi, Camille Claudel, alors âgée de plus de vingt ans, a séjourné à Gérardmer au mois d’août 1885 chez son oncle Isidore Gegout mari de Joséphine Claudel, et a dessiné au fusain, à cette occasion, une « femme de Gérardmer ».
De même, Paul Claudel a intégré dans son oeuvre le souvenir des fabriques de papier dont l’oncle paternel Charles Claudel et la famille de celui-ci étaient propriétaires. Dans sa pièce de théâtre « Le Pain dur », écrite en 1913-1914, juste après la mort de son père, il prête à son personnage Toussaint Turelure l’intention de transformer en manufacture de papier l’ancienne abbaye de Coûfontaine.
LES CLAUDEL ET LA COMMUNE VOSGIENNE DE LA BRESSE
L’environnement géographique et économique
Par leur père, la sculptrice Camille Claudel (1864-1943) et l’écrivain Paul Claudel (1868-1955), dont le patronyme est un diminutif de Claude, sont originaires de la commune de La Bresse (5655 habitants en 1911, 4728 habitants en 2006), située dans la partie amont de la vallée de la Moselotte qui rejoint la Moselle à Remiremont. Sur le territoire de cette commune se trouve le Hohneck (1363 m), qui est aussi le point culminant de la Lorraine. Le plus haut sommet du massif des Vosges étant le Grand Ballon (1424 m) en Alsace dans le département du Haut-Rhin.
Avant la fin du 18ème siècle, La Bresse, qui a réussi à garder jusqu’à la Révolution ses anciennes institutions de « petite république » (élection annuelle du maire, tribunal…) vivait principalement de l’élevage sur les hautes prairies de la montagne vosgienne appelées chaumes, et de la production de fromage (par les éleveurs fromagers appelés « marcaires »), ainsi qu’à un moindre degré de l’exploitation des forêts. Les notables de cette communauté étaient les marchands qui, grâce à une exonération de droits depuis le Moyen-Age entre la Lorraine, l’Alsace et la Bourgogne, faisant de ce lieu une sorte de zone franche et même une zone de contrebande, avaient développé un commerce qui donnait à cette communauté comme à celle de Gérardmer une prospérité inhabituelle dans un environnement aussi montagneux. Ils allaient vendre dans les régions voisines – y compris à la fin du 19ème siècle l’Alsace devenue allemande – les produits vosgiens, fromages, bois et articles de bois, tissus, et en rapportaient ce que les hautes Vosges ne produisaient pas, vin, eau-de-vie, céréales…
A la fin du 18ème siècle l’activité de filature et de tissage a commencé à se développer à grande échelle, à partir d’une matière première qui n’était plus le lin, mais le coton importé du « Levant » et d’Amérique, matière première transformée par la main d’œuvre paysanne qui avait l’habitude de ce genre de travaux pendant l’hiver. Puis l’emploi de machines textiles dès 1825-1830 a été favorisé par l’abondante force motrice des cours d’eau sur lesquels étaient installés depuis longtemps de nombreux moulins assez facilement reconvertis en moteurs hydrauliques pour les usines. Les Vosges sont ainsi devenues dans la première moitié du 19ème siècle un centre important de l’industrie cotonnière. Celle-ci n’était d’ailleurs pas la seule industrie, il faut mentionner aussi le développement de la fabrication mécanisée du papier.
C’est dans ce contexte que se situent les origines vosgiennes de la famille Claudel.
Une lettre de Paul Claudel au maire de La Bresse en 1946
Dans une lettre datée du 6 décembre 1946 (reproduite par Gabriel Remy dans son Histoire de La Bresse et des Bressauds, 1987) adressée à Eugène Lemaire, maire de cette commune dévastée à la fin de la guerre, Paul Claudel écrit ceci:
« Non, Monsieur Le Maire, je n’oublie pas La Bresse! Comment l’oublierais-je, la chère petite cité de qui le nom de Claudel est inséparable depuis je ne sais combien de générations ? N’est-ce pas sur un de vos registres paroissiaux qu’un chercheur a retrouvé le nom du patriarche Jacques Elophe Claudel, décédé en 1530, et de qui sont issus ou à qui se rattachent presque toutes les familles de la belle vallée ? C’est là qu’au début du siècle dernier, ma courageuse aïeule, restée veuve à la suite du décès accidentel de son mari, éleva une famille de six enfants.
Mon père, Louis Prosper Claudel, conservateur des hypothèques, n’oublia jamais sa petite patrie, et chaque fois que les vacances le lui permettaient, il emmenait sa famille au cimetière où notre nom se répétait aussi souvent sur les tombes que sur les enseignes de la localité… »
Paul Claudel et le destinataire de sa lettre, Eugène Lemaire, grand-père de l’auteur du présent article, avaient des ascendants communs (voir l’annexe).
Eugène Lemaire, maire de La Bresse de 1945 à 1953, a dû faire face aux difficultés de l’après-guerre comme son aïeul Joseph Lemaire, maire de 1870 à 1876, avait dû gérer les conséquences de la guerre franco-allemande de 1870-1871.
Généalogie simplifiée de Camille et Paul Claudel
Cette généalogie partielle remonte à Dominique Nicolas Claudel (La Bresse 15 octobre 1693-La Bresse 9 mai 1783), maire de La Bresse en 1734-1735, qui s’est marié à La Bresse le 10 septembre 1726 avec Marie Perrin (1705-1781).
Camille et Paul Claudel descendent de Dominique Nicolas Claudel par deux de ses fils: Blaise et Jacques.
Fils de Dominique Nicolas Claudel et de Marie Perrin, Blaise Claudel (La Bresse 2 février 1732-La Bresse 9 juin 1784), marchand, s’est marié à La Bresse le 8 juin 1753 avec Reine Rochatte (La Bresse 1728 ou 1729-La Bresse 3 juin 1784).
Blaise Claudel et Reine Rochatte sont les grands-parents maternels d’Elisabeth Chalon (née en 1794/9 germinal an 2) qui a épousé à La Bresse le 22 novembre 1814 (mariage entre cousins issus de germains) Nicolas Claudel (La Bresse 12 mars 1793-La Bresse 18 février 1830), cultivateur, boulanger, buraliste.
De ce mariage est né Louis Prosper Claudel, père de Camille et Paul Claudel.
Autre fils de Dominique Nicolas Claudel et de Marie Perrin, Jacques Claudel (La Bresse 25 juillet 1737-La Bresse 8 mars 1816), négociant, s’est marié à La Bresse le 9 janvier 1758 avec Catherine Paulot (1731-La Bresse 6 janvier 1806), originaire de Chatenois.
Jacques Claudel et Catherine Paulot sont les grands-parents paternels de Nicolas Claudel qui, on l’a vu ci-dessus, s’est marié avec Elisabeth Chalon, mariage qui a donné naissance à Louis (Louis Prosper) Claudel, père de Camille et Paul Claudel.
La généalogie des Claudel est présentée plus en détail en annexe, en lien avec celle d’Eugène Lemaire, maire de La Bresse de 1945 à 1953.
LES CLAUDEL A EPINAL, DOCELLES, GERARDMER
Il s’agit de descendants de Jacques Claudel (1737-1816) dont il vient d’être question.
Dominique Jacques Claudel et ses descendants
Petit-fils de Jacques Claudel, fils de Dominique Claudel et de Marie Marguerite Mengin, Dominique Jacques Claudel (La Bresse 1er janvier 1792–Epinal 30 janvier 1857), praticien (homme de loi, peut-être notaire) à Vagney en aval de La Bresse, par la suite négociant à Epinal et papetier à Docelles, s’est marié à Epinal le 18 août 1819 avec Marie Agathe Maldamé (Epinal le 2 frimaire an six-Epinal 6 septembre 1858), fille de Charles Maldamé (1747-1829), marchand de fer à Epinal, et de Marie Agathe Desjardins.
Les témoins de l’époux ont été :
– Jean Nicolas Claudel, âgé de 82 ans, avocat à Epinal, grand-oncle paternel de l’époux (et dernier fils survivant de Dominique Nicolas Claudel : voir l’annexe);
– Nicolas Claudel, âgé de 26 ans, frère de l’époux.
Dominique Jacques Claudel a acquis en 1842 le vieux moulin à papier de Vraichamp à Docelles près d’Epinal (Docelles est sur la Vologne, non loin du confluent avec la Moselle de cette rivière issue du lac de Gérardmer). Cette papeterie ayant appartenu à la famille de papetiers Krantz a été dotée de machines à la fin des années 1830 par Nivet Aîné et Cie. La famille Claudel en a été propriétaire et l’a dirigée au moins jusqu’en 1914.
Fils de Dominique Jacques Claudel et de Marie Agathe Maldamé, Félix Claudel (Epinal 15 août 1828-Docelles 28 avril 1875/acte du 29) s’est marié à Docelles le 17 octobre 1860 avec Marie Julie Krantz (Docelles 20 octobre 1842-Docelles/Vraichamp 1929), rentière, fille de Victor Emmanuel Krantz (1795-Docelles 1er mai 1850), fabricant de papier, et de Sophie Escallier (décédée à Docelles le 9 décembre 1894).
Les témoins des mariés Claudel-Krantz ont été :
– Charles Claudel, âgé de 36 ans, fabricant de papier, cousin germain et beau-frère de l’époux ;
– Louis Prosper Claudel, âgé de 34 ans, receveur de l’enregistrement à Fraize, cousin germain de l’époux, et frère de Charles Claudel ci-dessus;
– Sigisbert Emmanuel Escallier, âgé de 63 ans, propriétaire domicilié à Nancy, oncle maternel de l’épouse ;
– Léon (Marie Emmanuel Léon) Krantz, âgé de 28 ans, fabricant de papier, domicilié à Docelles, frère de l’épouse ; Léon Krantz a été maire de Docelles.
Du mariage entre Félix Claudel et Marie Julie Krantz sont nés à Docelles:
– Victor (Jacques Victor) Claudel (1862-1918), dernier dirigeant (gérant) de la papeterie de Vraichamp à Docelles ;
– Henry Claudel (1865-1909), dirigeant de la papeterie de Lana à Docelles ;
– Marguerite Claudel (née en 1871).
Nicolas Claudel et ses descendants
Frère de Dominique Jacques Claudel, fils de Dominique Claudel et de Marie Marguerite Mengin, Nicolas Claudel (La Bresse 12 mars 1793-La Bresse 18 février 1830), on l’a vu plus haut dans la « généalogie simplifiée de Camille et Paul Claudel », s’est marié à La Bresse le 22 novembre 1814 devant Laurent Aubert, adjoint du maire, avec Elisabeth (Marie Elisabeth) Chalon (La Bresse neuf germinal an II/29 mars 1794-Gérardmer 1er juin 1865), cultivatrice, fille du marchand Joseph Chalon et d’Elisabeth Claudel. Nicolas Claudel a été cultivateur, propriétaire, détaillant et buraliste. A la date du décès de son grand-père paternel Jacques Claudel, il était secrétaire de la mairie de La Bresse.
Nicolas Claudel et Elisabeth Chalon, qui descendent l’un et l’autre de Dominique Nicolas Claudel, arrière-grand-père commun, sont les parents de plusieurs enfants, dont: Joséphine, Elisabeth, Charles, Louis Prosper. Notons d’emblée que les soeurs Joséphine et Elisabeth Claudel ont épousé les frères Claude Pierre Isidore et Jean Nicolas Gegout de Gérardmer.
Joséphine Claudel
Fille de Nicolas Claudel et d’Elisabeth Chalon, Joséphine Claudel (née à La Bresse le 12 octobre 1816), alors cultivatrice, a épousé à La Bresse le 13 mai 1838 Isidore (Claude Pierre Isidore) Gegout (Gérardmer 14 mai 1812-Gérardmer 16 septembre 1887) :
– fils de Jean Antoine Gegout, marchand, et d’Elisabeth Georgel, boulangère, commerçante;
– armurier à son mariage, commerçant à la naissance de son neveu Nicolas Eugène en 1843, marchand de bois à la naissance de sa fille Amélie en 1850, négociant au décès de son frère Jean Nicolas en 1867 et au mariage de sa fille Amélie en 1872, buraliste quand il est décédé en 1887;
– à la date de son décès, veuf en premières noces de Joséphine Claudel.
Au mariage en 1838 de Joséphine Claudel avec Isidore Gegout, l’un des témoins a été Dominique Jacques Claudel (La Bresse 1er janvier 1792-1857), âgé de 46 ans, négociant à Epinal, oncle paternel de l’épouse (également témoin au mariage d’Elisabeth Claudel ci-dessous).
Fille d’Isidore Gegout et de Joséphine Claudel, Amélie (Marie Amélie Joséphine) Gegout (née à Gérardmer le 20 décembre 1850/acte du 22) a épousé à Gérardmer le 16 juillet 1872 Alexandre Albert Bedon (né à Luxeuil le 23 mars 1842), négociant à Luxeuil, en présence de ses parents et des témoins parmi lesquels:
– son frère Paul Louis Gegout, âgé de 29 ans, négociant, domicilié à Gérardmer;
– son oncle maternel Charles Claudel, âgé de 47 ans, manufacturier à Docelles.
Elisabeth Claudel épouse du maire de Gérardmer Jean Nicolas Gegout
Autre fille de Nicolas Claudel et d’Elisabeth Chalon, Elisabeth Claudel (La Bresse 14 décembre 1818/acte du 15-Gérardmer 24 juin 1869) a épousé à La Bresse le 24 septembre 1838 Jean Nicolas Gegout (Gérardmer 25 brumaire an XIV/16 novembre 1805-Gérardmer 11 juillet 1867), armurier, frère d’Isidore.
Jean Nicolas Gegout, conseiller municipal de Gérardmer à partir de 1840, a été maire de cette commune de 1847 à 1860.
Fils de Jean Nicolas Gegout et d’Elisabeth Claudel, Nicolas Eugène Gegout (Gérardmer 22 mars 1843-Champ le Duc 26 novembre 1897/acte du 27), négociant, marchand de bois, s’est marié à Champ le Duc le 6 avril 1872 avec Marie Berthe Poinsot (Brouvelieures 14 juin 1849-Champ le Duc 2 avril 1889). Les témoins de Nicolas Eugène Gegout ont été :
– Charles Claudel, âgé de 47 ans, manufacturier domicilié à Docelles, oncle de l’époux;
– Félix Claudel, âgé de 43 ans, manufacturier domicilié à Docelles, cousin de l’époux.
Charles Claudel fabricant de papier à Docelles
Fils de Nicolas Claudel et d’Elisabeth Chalon, Charles Claudel (La Bresse 14 décembre 1824-Docelles 16 janvier 1882), fabricant de papier à Docelles, s’est marié à Epinal le 24 novembre 1857 avec sa cousine germaine Charlotte Pauline Claudel (Epinal 28 août 1826-Epinal 29 avril 1868), rentière à Epinal, fille de feu Dominique Jacques Claudel, négociant, et de Marie Agathe Maldamé, propriétaire à Epinal. Les témoins des époux Charles Claudel et Charlotte Pauline Claudel ont été :
– Louis Claudel, âgé de 31 ans, receveur de l’enregistrement à Fraize, frère de l’époux ;
– Claude Pierre Isidore Gégout, âgé de 48 ans, négociant à Gérardmer, beau-frère de l’époux ;
– Nicolas Gégout, âgé de 51 ans, maire de Gérardmer ;
– Félix Claudel, âgé de 29 ans, fabricant de papier, frère de l’épouse.
Fille de Charles Claudel et de Pauline Charlotte Claudel, Marie Elisabeth Claudel (Docelles 26 mai 1860/acte du 27-Epinal 13 septembre 1935), marraine de Paul Claudel d’après un article de Ch. Courtin-Schmidt fondé sur des informations d’Henri Guillemin (voir la référence in fine), a épousé à Docelles le 23 octobre 1880 Stanislas (Marie Joseph Stanislas) Merklen (Mulhouse 30 mars 1850-Epinal 9 novembre 1914), notaire à Epinal, maire d’Epinal de 1911 à 1914, fils de Félix Pierre Merklen, âgé de 61 ans, propriétaire, et d’Anne Marie Joséphine Kieffer, âgée de 56 ans, domiciliés à Paris.
Les témoins des époux ont été :
– Marie Joseph Eugène Merklen, âgé de 36 ans, fabricant de gaz, domicilié à Remiremont, frère de l’époux;
– Marie Joseph Gustave Merklen, âgé de 33 ans, graveur, domicilié à Mulhouse, frère de l’époux;
– Louis Prosper Claudel, âgé de 54 ans, conservateur des hypothèques à Vassy, oncle paternel de l’épouse ;
– Charles Nicolas Pellerin (1827-1887), âgé de 52 ans, imprimeur imagiste à Epinal, cousin de l’épouse (Marie Jeanne Maldamé, grand-mère maternelle de Charles Nicolas Pellerin, étant sœur de Marie Agathe Maldamé, grand-mère maternelle de Marie Elisabeth Claudel). La famille Pellerin est célèbre pour la part importante qu’elle a prise dans l’industrie de l’image à Epinal.
Fils de Charles Claudel et de Charlotte Pauline Claudel, Louis (Charles Louis Jules) Claudel (Docelles 5 mars 1863-Ville sur Saulx dans la Meuse 23 septembre 1916), fabricant de papier à Docelles, s’est marié à Neufchâteau dans les Vosges le 27 octobre 1890 avec Mathilde (Marie Mathilde) Chapier (née à Neufchâteau le 21 octobre 1870), fille d’Alexandre Chapier, négociant, et de Marie Augustine Camille Leboeuf. Les témoins des époux ont été :
– Louis Claudel, âge de 64 ans, conservateur des hypothèques à Compiègne, oncle paternel de l’époux ;
– Stanislas Merklen, âgé de 41 ans, notaire à Epinal et futur maire de cette ville, beau-frère de l’époux ;
– Et deux cousins (issus de germains) de l’épouse.
Louis Claudel a acquis au début des années 1890 la papeterie et le château de Ville-sur-Saulx dans la Meuse. Au décès de son beau-père Alexandre Chapier, en 1899, il lui a succédé comme président du conseil d’administration de la station thermale de Martigny-les-Bains près de Neufchâteau. Il a été administrateur de la Banque de France. Sa papeterie de Ville-sur-Saulx, fondée au 14ème siècle, a fermé en 1972.
Autre fils de Charles Claudel et de Charlotte Pauline Claudel, Georges Claudel (né à Docelles le 11 avril 1864), docteur en médecine, s’est marié en 1896 avec Elisabeth Merklen (Mulhouse 28 juillet 1875-Remiremont 21 septembre 1963), fille de Gustave Merklen (Mulhouse 22 août 1847-Mulhouse 7 avril 1914), graveur sur rouleaux, et de Noémie Boelher.
Louis (Louis Prosper) Claudel conservateur des hypothèques
Le dernier enfant de Nicolas Claudel et d’Elisabeth Chalon est présenté ci-après avec sa fille Camille et son fils Paul.
LOUIS PROSPER, CAMILLE ET PAUL CLAUDEL
Louis (Louis Prosper) Claudel
Louis (Louis Prosper) Claudel (La Bresse 26 octobre 1826-Villeneuve sur Fère dans l’Aisne 2 mars 1913) s’est marié à Arcy Ste Restitue (02) le 2 février 1862 avec Louise Athanaïse Cécile Cerveaux (Fère en Tardenois dans l’Aisne 8 janvier 1840-Villeneuve sur Fère dans l’Aisne 19 juin 1929), fille d’un médecin, le docteur Athanase Cerveaux, et nièce de Nicolas Cerveaux, curé de Villeneuve-sur-Fère.
Louis Prosper et Louise Athanaïse Cécile Cerveaux sont les parents de :
– Camille Claudel (Fère en Tardenois 8 décembre 1864-Montfavet dans le Vaucluse 19 octobre 1943), sculptrice, célibataire;
– Louise Claudel (26 février 1866-3 mai 1935), qui a épousé le 16 août 1888 Ferdinand de Massary (décédé le 20 novembre 1896), magistrat; de ce mariage est né Jacques de Massary, médecin;
– Paul (Paul Louis Charles Marie) Claudel (Villeneuve sur Fère 6 août 1868-Paris 23 février 1955), écrivain, dont la vie est bien connue par ailleurs.
Fonctionnaire dans l’administration fiscale de l’enregistrement, Louis Prosper Claudel a été nommé :
– Receveur de l’enregistrement à Fraize, puis à Villeneuve sur Fère en 1860, et à Bar le Duc en 1870 ;
– Conservateur des hypothèques à Nogent sur Seine en 1876, à Wassy sur Blaise (Haute-Marne) en 1879, Rambouillet en 1883, Compiègne en 1887.
Il a été témoin au mariage de:
– son frère Charles Claudel à Epinal en 1857;
– son cousin germain Félix Claudel à Docelles en 1860 ;
– sa nièce Marie Elisabeth Claudel (fille de Charles) à Docelles en 1880 ;
– son neveu Louis Claudel (fils de Charles) à Neufchâteau en 1890…
Il était donc très lié à cette branche de la famille, propriétaire et gérante de fabriques de papier dans les Vosges et dans la Meuse.
Camille Claudel
Dans son livre de 2006 intitulé Camille et Paul, la passion Claudel (page 17 de l’édition en livre de poche), Dominique Bona écrit, au sujet des Claudel des Vosges : « Les enfants ont appris à les connaître et à les respecter, en allant passer quelques semaines par an avec leur père à Gérardmer, où un de leurs oncles est épicier et marchand de tabac ». Mais, selon elle : « ils ne se sentiront jamais vosgiens ni bressois (sic). Seul Paul nourrira quelque nostalgie de ces séjours espacés et brefs, consacrés à la marche, au grand air, et à regarder l’oncle débiter du géromé, le fromage géromois ».
Ces appréciations sous-estiment le niveau social de la famille vosgienne, de même que l’attachement de Camille aux Vosges. Ainsi, en août 1885, elle a passé ses vacances à Gérardmer chez son oncle paternel. A cette occasion, elle a dessiné au fusain une « femme de Gérardmer » (Musée Eugène Boudin à Honfleur). L’oncle paternel chez lequel elle a fait ce séjour est Isidore (Claude Pierre Isidore) Gegout, mari de Joséphine Claudel (voir plus haut).
Quelques jours seulement après la mort de son père en 1913, Camille, souffrant d’un délire de persécution vis-à-vis de Rodin dont elle avait été l’amante, a été internée dans un hôpital psychiatrique. Elle ne devait qu’à son père d’avoir échappé jusque là à l’internement.
Dominique Bona (pages 301-302) indique qu’un conseil de famille a été institué le 16 avril 1913 pour veiller sur les biens de Camille Claudel. Il était composé de: Paul Claudel; deux cousins des Vosges dont l’identité a été précisée plus haut, Alexandre-Albert Bedon (négociant, gendre d’Isidore Gegout et de Joséphine Claudel) et Louis Claudel (l’industriel papetier de Ville-sur-Saulx); deux amis de Paul Claudel, également liés à Camille, le peintre Henry Lerolle et le diplomate Philippe Berthelot ; et Félix Leydet, président du tribunal de la Seine.
Camille Claudel est restée enfermée jusqu’à sa mort en 1943, dans un asile du Vaucluse (Montdevergues) loin de sa famille, et quasiment privée de visites et de courrier. D’après Dominique Bona (page 346), quand les médecins de l’établissement, en 1920, ont recommandé un essai de sortie, la mère de Camille a refusé catégoriquement. Elle s’est même opposée à un rapprochement géographique suggéré par les médecins, à Paris ou près de Paris à Ville-Evrard. Après la mort de sa mère en 1929, Camille, malgré ses supplications, a été maintenue à Montdevergues par son frère (page 377). Quelque temps après sa mort, son corps a été inhumé dans la fosse commune (page 421). On peut se demander de quel poids, pour racheter tout cela, pèsent dans la balance l’œuvre de Paul Claudel, ou du moins ses bons sentiments religieux. Dans ses entretiens avec Jean Amrouche en 1951 (Mémoires improvisés publiés en 1954), l’écrivain a eu encore des mots terribles au sujet de sa sœur (cités par Dominique Bona, pages 426-427, se référant à la page 332 des Mémoires improvisés) : « Moi, j’ai abouti à un résultat. Elle, elle n’a abouti à rien ». Et: « L’échec a flétri son existence». Mots terribles, témoignant peut-être surtout contre celui qui les a prononcés.
Paul Claudel
Dans un article intitulé « Les Claudel de La Bresse », publié par le journal La Liberté de l’Est du 30 août 1955 (reproduit sur le site internet Ecrivosges), Ch. Courtin-Schmidt, d’après des souvenirs de Paul Claudel rapportés par Henri Guillemin dans la Revue de Paris, évoque les séjours d’été que les enfants Claudel ont faits vers 1875-1880 à La Bresse, où ils cueillaient des brimbelles (myrtilles) et se baignaient dans le Lac des Corbeaux. Paul Claudel a dit aussi à Henri Guillemin: « Nous allions parfois à Docelles, où l’oncle Charles avait une papeterie, et à Epinal (sic) où l’oncle Isidore tenait un bureau de tabac ».
L’activité des Claudel de Docelles, manufacturiers fabricants de papier, fait penser à la pièce de théâtre de Paul Claudel intitulée Le Pain dur (datée par l’auteur à la fin du texte : « Hambourg, octobre 1913. Bordeaux octobre 1914 »), écrite après la mort de Louis Prosper Claudel, deuxième volet de la trilogie formée avec L’Otage et Le Père humilié. Dans cette pièce dont l’action se passe sous Louis-Philippe, Toussaint Turelure, ancien révolutionnaire, baron d’Empire puis comte, devenu affairiste, veuf de Sygne de Coûfontaine, déclare, à propos de l’ancienne abbaye rachetée par Sygne: « Ce monastère va devenir une papeterie », c’est-à-dire une fabrique de papier. Comme L’otage, pièce précédente, Le Pain dur commence dans la bibliothèque de cette abbaye désaffectée (et s’y déroule d’ailleurs entièrement). « Tous les livres ont été enlevés des rayons et on voit des piles çà et là sur le plancher. Désordre et poussière; aux fenêtres, par places, carreaux remplacés par du papier… » Turelure essaie en vain de vendre les livres. « Je vais en faire du feu », dit-il (acte I, scène II).
Cette histoire fait aussi penser à l’abbaye de Senones près de Saint-Dié, vendue à la Révolution et transformée en filature de coton. Cette entreprise a été exploitée dans les bâtiments de l’abbaye de 1796 à 1981, notamment par la famille Seillière.
Par ailleurs, d’après les sites internet relatifs à la commune de Ville-sur-Saulx, Paul Claudel a écrit là en 1905, dans le château de son cousin Louis industriel papetier, une partie au moins de sa pièce Partage de Midi.
Quant à la lettre précédemment citée de l’écrivain au maire de La Bresse en 1946, elle ne semble pas témoigner d’un grand enthousiasme à l’égard des Vosges. Elle donne à imaginer la réticence de l’enfant que son père entraînait chaque année au cimetière et la monotonie des tombes sur lesquelles se répétait le nom de Claudel. Le parallèle fait par l’écrivain entre les tombes et les enseignes des commerces renforce l’impression que, dans cette commune, l’écrivain ne voyait pas la singularité d’individus familiers, mais une collectivité de personnes indistinctes. Quant à l’exclamation : « non, je n’oublie pas La Bresse ! », Paul Claudel la reprend dans sa lettre avec plus de conviction à propos de son père qui, écrit-il, « n’oublia jamais sa petite patrie ».
Dominique Thiébaut Lemaire
ANNEXE: LIENS GENEALOGIQUES ENTRE LES CLAUDEL ET LES LEMAIRE
Les naissances, mariages et décès datés dans cette annexe ont eu lieu à La Bresse, sauf quelques exceptions explicitement indiquées.
Deux mariages sont communs aux ascendances Claudel et Lemaire :
– celui de Joseph Chalon et de Marie Anne Claudel, qui se sont mariés en 1758 ;
– Plus loin dans le temps, celui de Dominique Nicolas Claudel et de Marie Perrin, qui se sont mariés en 1726.
Lien de parenté le plus étroit
Petit-fils de Dominique Chalon, maréchal ferrant à La Bresse au début du 18ème siècle, Joseph Chalon (1er septembre 1733-10 mars 1811) s’est marié le 9 janvier 1758 avec Marie Anne Claudel (21 août 1739-15 juillet 1801), fille de Laurent Michel Claudel et de Marie Anne Arnould.
De Joseph Chalon descendent à la fois la famille vosgienne de Camille et Paul Claudel, et la famille Lemaire de La Bresse.
Pour donner une idée des « distances » en nombre de générations, Joseph Chalon est un arrière-grand-père :
– de Louis (Louis Prosper) Claudel, lui-même père de Camille et Paul Claudel,
– ainsi que de Joseph Lemaire (maire de La Bresse de 1870 à 1876), lui-même grand-père d’Eugène Lemaire (maire de La Bresse de 1945 à 1953).
La descendance Claudel de Joseph Chalon
La descendance Claudel de Joseph Chalon sur quatre générations successives (après celle de Joseph Chalon) est la suivante:
– Fils de Joseph Chalon et de Marie Anne Claudel, Joseph Chalon (23 avril 1769-29 mars 1819), marchand, s’est marié 4 mai 1790 avec Elisabeth Claudel (20 février 1770-17 octobre 1808), fille de Blaise Claudel et de Reine Rochatte ;
– Fille de Joseph Chalon et d’Elisabeth Claudel, Elisabeth (Marie Elisabeth) Chalon (29 mars 1794-1875) a épousé le 22 novembre 1814 son petit-cousin Nicolas Claudel (12 mars 1793-18 février 1830), boulanger, cultivateur, débitant de tabac ;
– Nicolas Claudel et Elisabeth Chalon sont les parents de Louis Prosper Claudel;
– celui-ci est le père de Camille et Paul Claudel.
La descendance Lemaire de Joseph Chalon
Parallèlement à la descendance Claudel, la descendance Lemaire de Joseph Chalon sur quatre générations successives (après celle de Joseph Chalon) est la suivante:
– Laurent Aubert (19 septembre 1762-3 octobre 1834/acte du 4 octobre), débitant, marchand, adjoint de son frère Etienne maire sous le Consulat et l’Empire, s’est marié le 31 janvier 1785 avec Hélène Chalon (31 mai 1761-30 janvier 1825), fille de Joseph Chalon;
– Dominique Lemaire (26 mai 1784-2 février 1850), cultivateur, négociant, fils de marchand et frère de négociants, s’est marié le 20 septembre 1809 avec Jeanne Hélène Aubert (11 janvier 1786-12 juillet 1839);
– Joseph Lemaire (5 mai 1818-16 octobre 1898), négociant, maire de La Bresse de 1870 à 1876, s’est marié le 25 janvier 1842 (mariage entre cousins issus de germains) avec Marie Anne Aubert (16 août 1820/acte du 17 août-15 septembre 1883) ;
– Constant (Joseph Louis Constant) Lemaire (15 avril 1845-15 janvier 1898), voiturier, marchand de fromages en gros, s’est marié en secondes noces le 29 décembre 1885 avec Pauline (Marie Pauline Virginie) Jeangeorge (16 octobre 1858-3 mars 1891), fille de manufacturiers du textile.
Né du mariage Lemaire-Jeangeorge, Eugène Lemaire (19 juillet 1888-4 août 1968), comptable, maire de La Bresse de 1945 à 1953, s’est marié le 9 janvier 1912 avec Marie Angèle Ehlinger (8 février 1893-18 janvier 1959).
Autre lien de parenté
Fils de Nicolas Dominique et de Barbe Fleurance, Dominique Nicolas Claudel (15 octobre 1693-9 mai 1783) s’est marié le 10 septembre 1726 avec Marie Perrin (décédée le 10 mai 1781). Il a été maire de La Bresse en 1734-1735.
Camille et Paul Claudel descendent à la fois de deux fils de Dominique Nicolas Claudel : Blaise Claudel (1732-1784) et Jacques Claudel (1735-1816).
Les Lemaire, quant à eux, descendent d’un autre fils de Dominique Nicolas Claudel: Dominique Claudel (né en 1734).
Dominique Nicolas Claudel est un arrière-grand-père à la fois de Nicolas Claudel et d’Elisabeth Chalon, grands-parents paternels de Camille et Paul Claudel.
Il est aussi un arrière-grand-père de Joseph Aubert, lui-même arrière-grand-père d’Eugène Lemaire.
Il convient d’évoquer ici, au passage, outre Blaise, Jacques et Dominique, un quatrième fils de Dominique Nicolas Claudel : Jean Nicolas Claudel (La Bresse 1739-Epinal 14 novembre 1824), reçu avocat à la cour de Lorraine en 1764, qui s’est marié à Epinal le 28 février 1769 avec Anne Catherine Michel. De cette union est né à Epinal le 5 janvier 1782 Dominique Gaspard Claudel, qui s’est marié à Epinal le 19 janvier 1809 avec Anne Marie Josèphe Peudefer (née à Epinal le 19 mars 1787), fille de Charles Ambroise (notaire à Epinal). Dans les années 1820, Dominique Gaspard Claudel a été notaire à Vagney, commune située en aval de La Bresse dans la vallée de la Moselotte.
La descendance Claudel de Blaise et Jacques Claudel, tous deux fils de Dominique Nicolas
En ce qui concerne Blaise Claudel :
– Celui-ci (2 février 1732-9 juin 1784), marchand, s’est marié le 8 juin 1753 avec Reine Rochatte (1728 ou 1729-3 juin 1784).
– Fille de Blaise Claudel et de Reine Rochatte, Elisabeth Claudel (1770-1808) a épousé le 4 mai 1790 Joseph Chalon (1769-1819) marchand, agent municipal (maire) en l’an V ou fils du maire de l’an V.
– Fille de Joseph Chalon et d’Elisabeth Claudel, Elisabeth Chalon (née en 1794/9 germinal an 2) a épousé le 22 novembre 1814 (mariage entre cousins issus de germains) Nicolas Claudel, cultivateur, boulanger, buraliste. De ce mariage est né Louis (Louis Prosper) Claudel, père de Camille et Paul Claudel.
Blaise Claudel est également le père de Nicolas Claudel (né en 1761), marcaire (fromager), qui s’est marié à Cornimont en 1781 avec Catherine Grosjean. De ce mariage est née Marie Anne Claudel (1796-1847) qui a épousé en 1817 Valentin Abel, maire de La Bresse de 1833 à 1848, et l’un des plus importants manufacturiers du textile de La Bresse au cours de la période 1830-1860.
En ce qui concerne Jacques Claudel :
– Celui-ci (25 juillet 1737-8 mars 1816), négociant, rentier au mariage de son petit-fils Nicolas en 1814, s’est marié le 9 janvier 1758 avec Catherine Paulot (Chatenois?1731-La Bresse 6 janvier 1806);
– Fils de Jacques Claudel et de Catherine Paulot, Dominique (Dominique Jacques) Claudel (1764-28 floréal an onze/1803), boulanger, marchand, s’est marié le 7 mars 1791 avec Marie Marguerite Mengin (Charmes? 1768-La Bresse 1838), boulangère.
– Fils des précédents, Nicolas Claudel (12 mars 1793-18 février 1830) s’est marié le 22 novembre 1814 avec Elisabeth Chalon (mariage entre cousins issus de germains). De ce mariage est né Louis (Louis Prosper) Claudel, père de Camille et Paul Claudel.
Autre fils de Jacques Claudel et de Catherine Paulot, Elophe Claudel (1761-1815) s’est marié le 27 novembre 1781 avec Catherine Perrin (1759-1831). Du mariage d’Elophe Claudel sont nés notamment :
– François Claudel (4 octobre 1785-19 septembre 1850), qui s’est marié le 13 octobre 1807 avec Elisabeth Valentin (18 novembre 1778-14 janvier 1866). François Claudel possédait dès le début des années 1830 une manufacture à La Bresse. Son beau-frère Charles Valentin était son associé dans cette entreprise textile « Valentin et Claudel » qui s’est développée jusqu’aux années de crise du coton, dans la décennie 1860. François Claudel a été par ailleurs maire de 1830 à 1835. C’est sous son mandat, grâce à lui et grâce à l’effort collectif des habitants, que La Bresse a fait reconnaître la propriété communale de ses forêts ;
– Marie Anne Claudel (12 novembre 1790-2 juillet 1862), qui a épousé en secondes noces le 8 mai 1821 Alexandre Aubert (8 brumaire an 6/29 octobre 1797-7 avril 1887), cordonnier (1821), cabaretier (1834), boulanger (1849), frère de Jeanne Hélène Aubert qui a épousé en 1809 Dominique Lemaire (voir plus haut « la descendance Lemaire de Joseph Chalon »). De ce mariage Aubert-Claudel est née Marie Virginie Aubert qui a épousé en 1849 Constant Perrin, manufacturier, négociant ; cette union est à l’origine de la branche Perrin des dirigeants de la plus importante entreprise textile de cette partie des Vosges, entreprise dénommée « Les héritiers de Georges Perrin » (HGP), dirigée par la même famille du milieu du 19ème siècle à la fin des années 1980.
La descendance Lemaire de Dominique Claudel, autre fils de Dominique Nicolas
Les générations successives de la descendance Lemaire de Dominique Nicolas Claudel (après la génération de celui-ci) sont les suivantes :
– Dominique Claudel (né en 1734) s’est marié le 1er septembre 1766 avec Anne Perrin (1746-1825) ;
– Etienne Aubert (22 décembre 1764-30 janvier 1831), marchand, maire de La Bresse de 1811 à 1815, frère de Laurent Aubert (voir plus haut la « descendance Lemaire de Joseph Chalon »), s’est marié le 13 février 1792 avec Anne Claudel (25 juillet 1773-21 avril 1827) ;
– Joseph Aubert (3 novembre 1797-1er février 1864), fromager et marchand, s’est marié le 23 novembre 1819 avec Marie Vaxelaire (1er juin 1794-18 janvier 1864), d’une famille de marcaires ;
– Joseph Lemaire, négociant, maire de La Bresse de 1870 à 1876, s’est marié en 1842 (mariage entre cousins issus de germains) avec Marie Anne Aubert (voir plus haut);
– Constant Lemaire, voiturier, marchand de fromages en gros, s’est marié en 1885 avec Pauline Jeangeorge, fille de manufacturiers du textile (voir plus haut).
Né du mariage Lemaire-Jeangeorge, Eugène Lemaire, comptable, maire de La Bresse de 1945 à 1953, s’est marié en 1912 avec Marie Angèle Ehlinger (voir plus haut).
SOURCES
– Registres paroissiaux et d’état civil sur internet (archives départementales des Vosges)
– Fichiers de l’Union des cercles généalogiques lorrains (UGCL)
– Perrin (Laurent) : base de données généalogiques (internet)
– Wintzer (Nicolas) : généalogie 88 sud-est (internet)
– Bona (Dominique) : Camille et Paul, la passion Claudel, Grasset, 2006 (les passages cités font référence à l’édition du Livre de poche d’avril 2009)
– Claudel (Paul) : L’Otage et Le Père Humilié
– Courtin-Schmidt (Ch.): »Les Claudel de La Bresse », article paru dans La Liberté de l’Est du 30 août 1955, et reproduit par le site internet EcriVosges
– Remy (Gabriel) : Histoire de La Bresse et des Bressauds, 1987