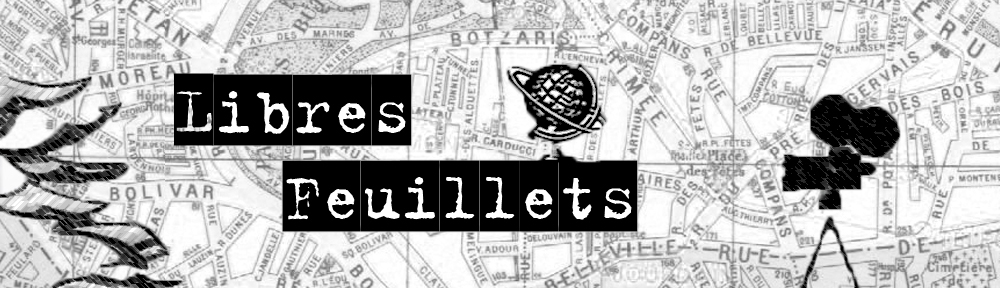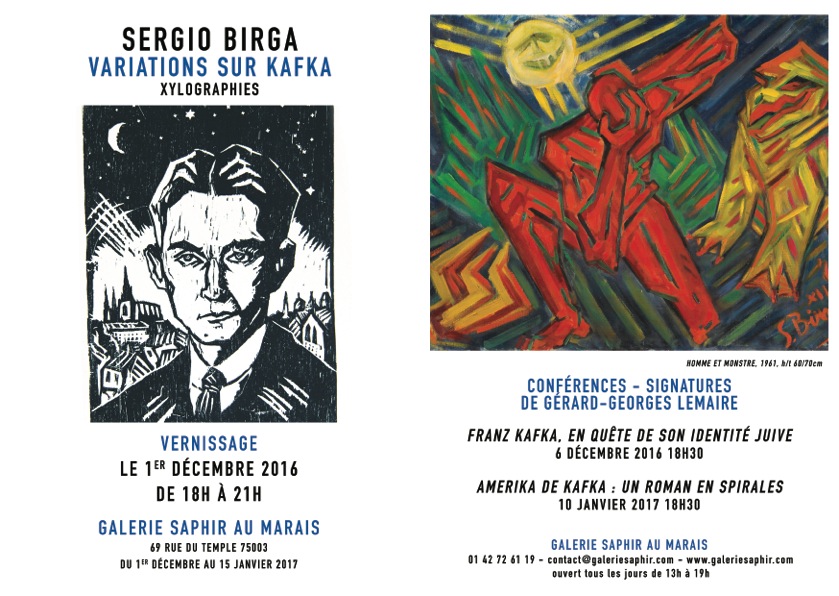Les écarts entre espérances, promesses et réalité
La politique est animée par l’espérance, par les attentes que les candidats aux fonctions dirigeantes doivent s’engager à satisfaire pour être élus. Aux espérances des uns répondent plus ou moins sincèrement les promesses des autres.
L’action politique doit aussi prendre en compte la réalité, celle qui lui résiste, la force des choses, « ce qui ne dépend pas de nous » par opposition à « ce qui dépend de nous », pour reprendre une distinction chère aux philosophes (les Stoïciens, ou Descartes, par exemple). Mais il faut avoir cherché préalablement à bien comprendre sur quoi nous avons prise.
Le mensonge réside dans les écarts entre l’espérance, les promesses et la réalité.
Promettre l’impossible, c’est mentir. Malheureusement, ce mensonge ne déplaît pas, on s’imagine qu’il a de la grandeur : Impossible n’est pas français, dit-on ; soyez réalistes, demandez l’impossible, a-t-on dit en mai 68.
L’espérance et les promesses
L’espérance est considérée par le christianisme comme l’une des trois vertus théologales. Elle est fortement présente aussi dans le communisme et le socialisme, fondés sur l’espoir d’un monde meilleur. Mais Descartes, dans Les Passions de l’âme, écrit justement qu’elle est une passion avant d’être une vertu. En tant que passion, elle peut être mensongère. Elle naît la plupart du temps du désir plutôt que de la raison. Elle naît aussi de la joie que l’on attend. Or, comme l’a noté le philosophe, les passions qui naissent de la joie sont plus difficiles à maîtriser que celles qui naissent de la tristesse.
Face à l’espérance, il arrive souvent que, selon une formule cynique tirée de l’expérience, « les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent ». On peut distinguer deux sortes de fausses promesses : celles dont le prometteur s’aperçoit ensuite qu’elles ne sont pas tenables, et celles qu’il sait d’emblée ne pouvoir tenir, mensonge délibéré. Cela dit, la distinction entre le mensonge d’une part, l’ignorance ou la bêtise d’autre part, est souvent floue. Ainsi, il peut être facile d’invoquer l’ignorance pour s’exonérer de l’accusation de mensonge. Pour éviter ce travers, mieux vaut essayer de choisir (en refusant que ce soit un vœu pieux) des hommes politiques ayant suffisamment de raison, c’est-à-dire d’intelligence et de savoir.
La force des choses
Certains pensent que l’ordre existant est l’exact reflet de la force des choses, et que, pour reprendre une expression aujourd’hui répandue, « il n’y a pas d’alternative ».
D’autres pensent qu’il faut revenir à un état antérieur plus « naturel », et dénomment réformes (parce que ce mot est toujours pris aujourd’hui dans un sens positif) des programmes et des actions régressives.
D’autres encore considèrent qu’il faut nécessairement aller de l’avant sans arrêt et que, grâce au « progrès », la force des choses n’existe plus. Les avancées des sciences et des techniques tendent à les persuader que presque tout dépend ou dépendra de nous.
Ces trois attitudes simplistes, plaquées a priori sur une réalité complexe, continuent à séduire parce qu’elles font partie du « prêt à penser » qui évite l’effort de réfléchir. Elles sont toutes les trois des sources d’erreur et de tromperie.
Autre source d’erreur et de tromperie communément répandue : croire et faire croire que la vérité et le bien vers lesquels nous devons tendre nous sont révélés par ce que font les autres, c’est-à-dire, dans notre monde, grâce à ce qu’on appelle en franglais le « benchmarking », c’est-à-dire en l’occurrence les comparaisons par rapport aux moyennes internationales.
Or celles-ci ne sont pas assez fines pour permettre de comparer vraiment ce qui est comparable. Ceux qui utilisent ces données – hommes politiques, experts plus ou moins médiatiques ou politisés – trompent leur public en feignant d’en maîtriser la signification. Ils n’ont généralement pas une idée assez précise des réalités étrangères, et de toutes les précautions à prendre pour apprécier avec justesse la portée des chiffres invoqués. Bref, comparaison n’est pas raison.
Aux effets de l’ignorance s’ajoutent dans ce « comparatisme » les effets de la rivalité, de la compétition, de la surenchère, et même de l’envie. Il existe une propension à croire que l’autre est toujours mieux loti que soi, et qu’il faut le suivre pour l’égaler ou le dépasser, alors qu’il serait préférable de penser à se dépasser soi-même.
Dominique Thiébaut Lemaire