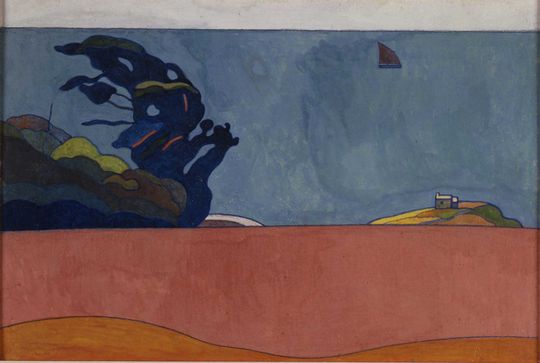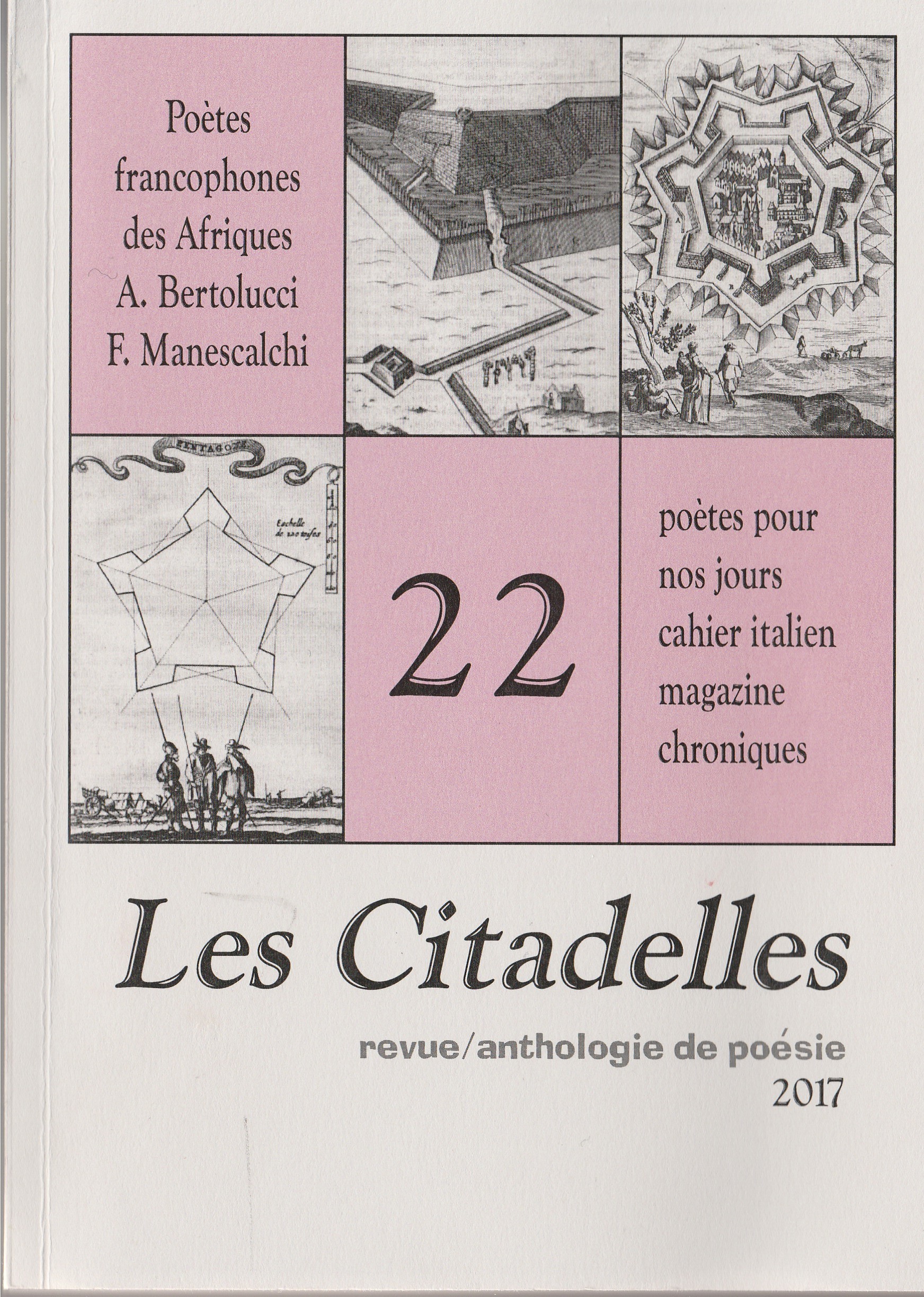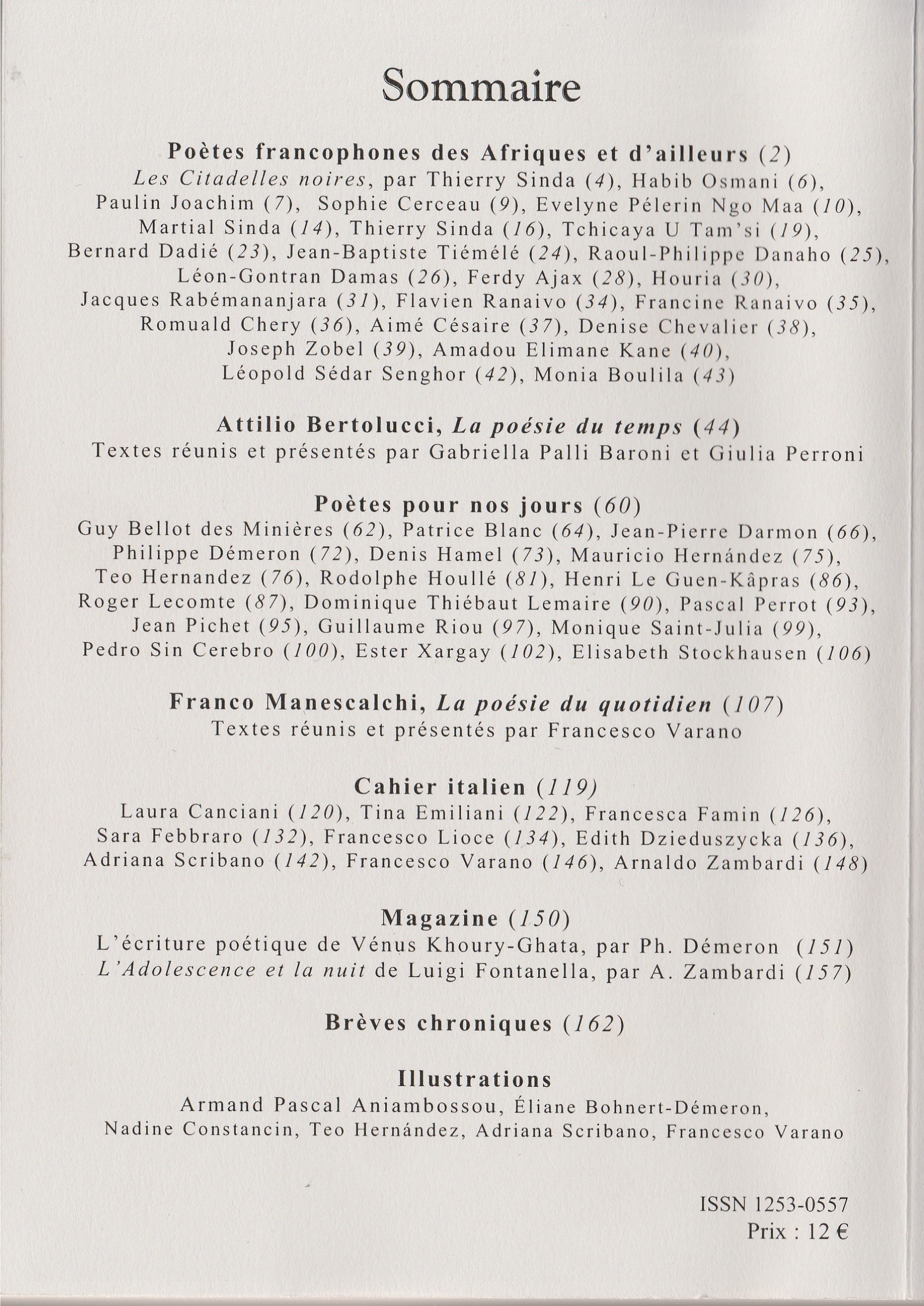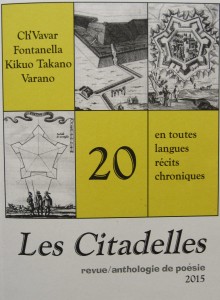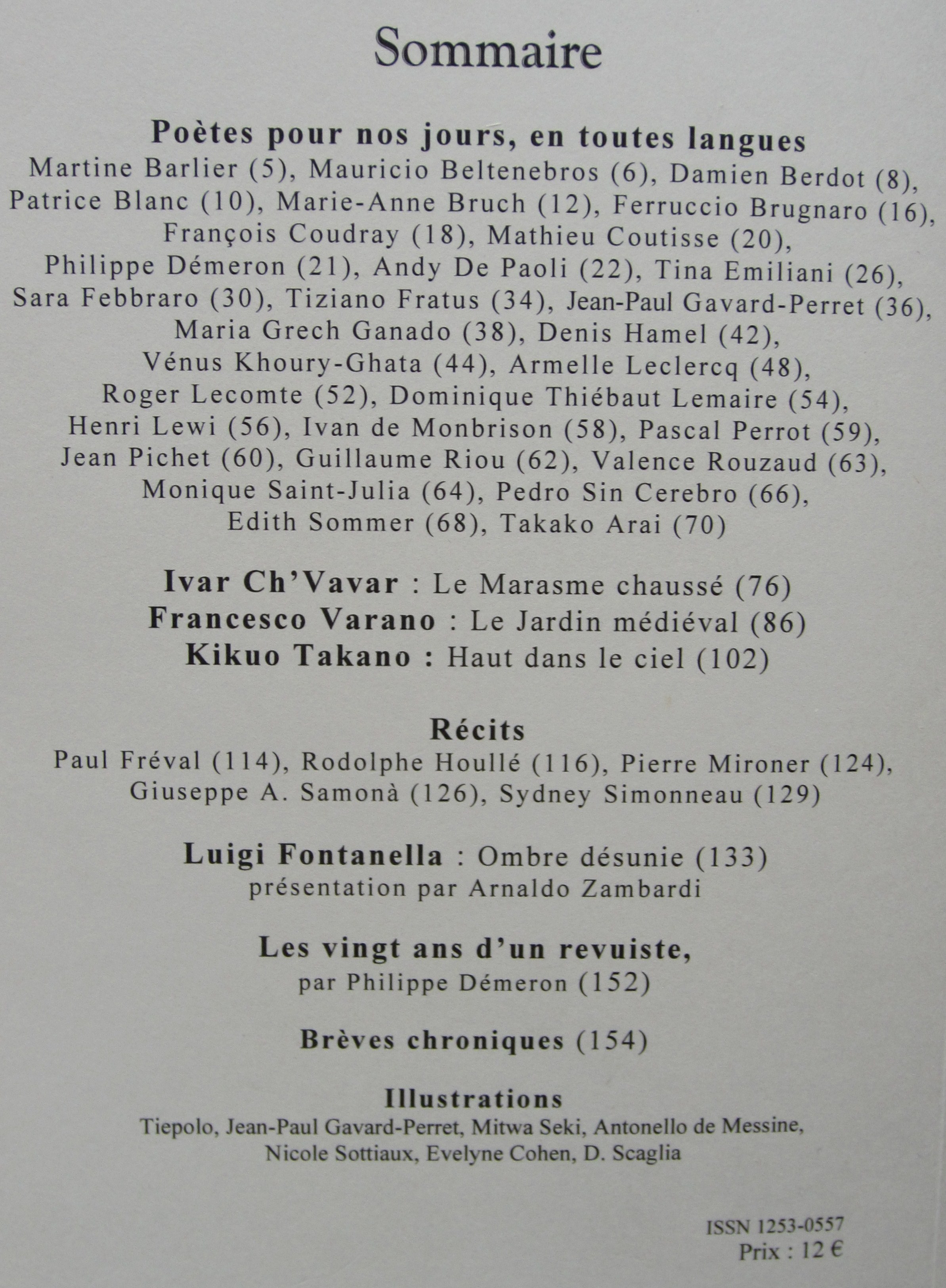Dans le présent article, il est question de deux textes (transmis par Dorothy Nakos), rédigés par Yvi Le Beux. au cours des dernières années de sa vie.
L’un est un texte d’histoire, consacré à la découverte de l’Amérique, remontant aux Vikings et détaillant l’exploration de l’embouchure du Saint-Laurent par Jacques Cartier (1491-1557), navigateur breton originaire de Saint-Malo.
L’autre texte, sous forme de fable, décrit la vie des grenouilles et des rats dans un grand marécage de l’Amérique du Nord. D’après Dorothy Nakos, ce serait une parodie de la vie politique au Québec… Des extraits de ce second texte de 36 pages sont cités ci-après.
P.1-8 :
« Dans le frisquet d’une aube blafarde, le ciel a gardé une couleur gris métallique. La grande froidure à peine terminée, le soleil s’est levé avec difficulté, mais, dès l’aurore, se fait éclatant, inondant de ses rayons déjà chauds une végétation encore figée, qui ne
demande qu’à s’épanouir à la lumière d’un été déjà proche. A une dormance prolongée
fait brutalement suite une reprise active de la vie qui, succédant au tumulte des éléments,
s’avère d’autant plus fébrile qu’elle est courte. Dans l’immensité de la contrée vaste comme un continent, parsemée de nombreux lacs s’étendant jusqu’à l’horizon, s’est animé le grand marécage aux frontières indécises, dit le Marécage, d’où s’élève une clameur d’indignation, périodiquement. Faune, flore n’y sont que formes de
l’environnement. La vie des êtres signifie celle du monde qu’ils peuplent mais, d’un lieu
à l’autre, diffère sans pourtant exclure l’une ou l’autre des communautés, car, malgré
leurs particularités, elles n’ont jamais cessé de coexister.
Le marécage revient à la vie, qu’il semblait avoir perdue, au moins momentanément. Grenouilles, crapauds des roseaux, qui la tête enfouie dans la vase, qui abrités dans les anfractuosités de quelques blocs de rochers de la berge, se tenaient
immobiles, s’activent maintenant…. Au fur et à mesure que la chaleur du soleil dissipe les brumes du matin s’élevant du marécage, la frénésie de la vie chasse l’engourdissement du sommeil. À l’approche du marécage, le ciel est empli du bruissement de bestioles grouillantes, débouchant de n’importe où, à n’importe quel moment ! La quête du suc des visiteurs les rend très agressives. Intrépides, elles fondent sur leurs victimes au hasard des rencontres.
Dans ce monde aux actions franches, directes, sans aménité, vivent aussi d’autres
pensionnaires à l’allure paisible, qui sur un lit de verdure, qui assis sur une feuille de
nénuphar, attendent qu’on vienne à eux pour se rassasier à leur tour. La nourriture y est
vraiment abondante. Y vit-il en harmonie, ce petit monde ? On s’entre-dévore et on se
reproduit. La nature le lui a enseigné. Rien ne se perd ni ne se crée dans cet univers….Parmi joncs, roseaux et autres plantes aquatiques, s’ébattent des grenouilles
attroupées. Dans la nonchalance de l’après-midi ensoleillé, elles coassent gaiement.
Sans doute racontent-elles les dernières aventures de leur retour à la vie sociale. La
saison active vient de commencer et ça jase déjà fort. Que de gentilles commères ! Sur
la berge, des crapauds américains prennent leur bain de soleil, tout en zieutant les belles
grenouilles. A l’écart, parmi les nénuphars, se tient toujours au même endroit que la
veille, la tête hors de l’eau, immobile, comme figée, à la façon d’un périscope de sous-
marin, une énorme Grenouille. Elle observe, plutôt elle scrute. Elle est aux aguets. Le
majestueux personnage, c’est Ouaouaron. Grimpée au faîte d’un bouleau, près de la
berge, une petite grenouille d’un bleu-vert tendre, brillant, s’est agrippée à l’une des
branches, à l’aide de ses petites pelotes charnues à l’extrémité des doigts. Une patte
après l’autre, elle avance le long de la branche, se déplaçant lentement. Elle épie entre le
feuillage, tout en ne quittant pas des yeux le moindre geste de son compagnon. De son
poste d’observation, elle scrute aussi à l’entour. Cette gentille créature, c’est Hyla. Dans
cet univers où s’entre-dévorer est la règle, Ouaouaron et Hyla se sont unis pour pouvoir y
continuer à vivre. Ils se sont ainsi liés d’affection.
Après un hiver des plus rigoureux, prolongé d’une quinzaine, l’atmosphère est
désormais à l’optimisme dans le Marécage. La nuit durant, le ronflement continu des
mâles l’a tenu en éveil. Le temps est venu de répondre à l’appel de la race selon le maître
à penser Alonie, le choucas très futé qui veille à la spiritualité de la gent grenouille. Et de
se rendre à l’étang des amours. Le chemin est court. Par une belle journée ensoleillée du
printemps, après s’être réchauffés l’après-midi durant, les sieurs y sont arrivés les
premiers. Qu’ils sont empressés à courir le guilledou ! Et, le crépuscule venu, ils
poussent leur romance et n’auront pas de cesse qu’ils n’aient obtenu ce qu’ils veulent, la
présence des dames. Nageant inlassablement, les sieurs manifestent de l’impatience.
Certains se méprennent et étreignent, qui un compère, qui un crapaud parmi les roseaux.
Ça grogne…et de lâcher prise. Enfin, voilà une dame ! Se ruent nombre de sieurs qui
tentent de la saisir, de l’étreindre, de se cramponner à toute chair encore disponible.
Impossible ! Si ce n’est de s’entasser les uns sur les autres, une marée de grenouilles
engluées en une vaine consommation, sans délices. A la lisière de l’impulsive brutalité
aveugle, le jeu de l’amour et du hasard triomphe enfin ! Un sieur Grenouille, comme tant
d’autres le font encore, appelle sa dame de son chant qui a l’heur de la séduire. Dieu, le
ciel l’aurait-il exaucé ! De son cloaque se dégagent alors des effluves si odoriférants
qu’elle tombe ! Il ne lui reste plus qu’à l’étreindre de ses bras, d’un geste convulsif, à
l’embrasser en arrière des siens et à se cramponner à son dos, la nature l’ayant pourvu de callosités sur les doigts des mains et sur différentes parties du corps. L’énorme dame
Grenouille esquisse quelques pas de danse, un petit sieur agrippé au dos. Au terme d’un
laps de temps plus ou moins long, elle livre à la nature une myriade d’œufs que son
partenaire de petite taille couvre d’une semence épaisse. La nature disposera ainsi de
grappes d’œufs fécondés. Le devoir accompli, l’étreinte se desserre. Le sort en est jeté.
La dame quitte l’étang des amours. Le sieur appelle encore. Il est toujours disponible.
L’accouplement, c’est l’infini mis à la portée des grenouilles aussi longtemps que se
maintiendra l’espèce, pourvu que l’environnement leur prête vie. Ainsi naissent les
têtards, une manne dans le Marécage, qui survit toujours. On va pouvoir continuer à y
faire bonne chère. Elle est délectable, exquise même et abondante.
La gent grenouille va pouvoir maintenant couler des jours paisibles et se prélasser.
En quelque sorte, c’est un coin de paradis. A l’acmé de l’un de ces après-midi tranquilles,
mais étouffants, subitement, voilà que clapote l’onde dans le Marécage. Le calme brisé,
les pensionnaires somnolentes sont frappées de stupeur. Elles se sont instantanément
tues. L’inquiétude grandit. Dérangée, la gent grenouille, fort avisée et peureuse, est prise
d’une grande panique. Peu s’en faut, ces aimables créatures ne font voir leur derrière
qu’à peine l’espace d’un instant, plongent prestement au fond de l’onde et se dissimulent
là où ce n’est qu’eau et vase, en remuant vivement les pattes de derrière au passage.
Encore des flocs incessants ! Elles se cachent aux regards indiscrets dans l’onde.
Pourquoi ce branle-bas ? Nul ne le sait. Sieur Héron, dame Couleuvre ne sont pourtant
pas sur les lieux. Le temps s’écoule, fuyant même. Le danger passé, timidement,
quelques grenouilles se hasardent à remonter à la surface, suivies graduellement par
d’autres. La tête hors de l’eau, elles se mettent à coasser bruyamment, en prenant le ciel
à témoin. Tout va mal, rien ne va bien, les pensionnaires du Marécage coassent les unes
après les autres. Le Marécage en résonne. L’optimisme est de retour. Il n’y pas au
monde plus avisée que la gent marécageuse. Le calme est revenu.
Il n’est d’éden que dans l’imaginaire. Dans l’univers du Marécage grouillant de
pensionnaires, continuer d’être peut dépendre de l’agilité d’un saut ou du camouflage.
Ouaouaron, au rictus superbe, toise encore et toujours. De sa propre initiative, il s’est
proposé d’aider ainsi ce peuple agile et fier, le peuple marécageois. Hyla, sa dulcinée,
n’en est que plus fière. Il suppute, de temps à autre, ses chances de pouvoir
continuer à le faire. Pourquoi ne serait-il pas comblé à son tour ? Cela lui permettrait de
faire honneur à Hyla, la gracieuse rainette, sa fidèle compagne en ce monde, où lutter
pour survivre à la prédation nécessite une attention de tous les instants. Elle lui prodigue
avec constance talent et énergie, tantôt en l’assistant dans l’activité de surveillance, tantôt
en le conseillant. Elle se sent en sécurité avec lui, mais elle déteste tremper dans la mare
aux grenouilles. Elle encourage Ouaouaron à s’entourer de collaborateurs. Camomille,
un sage, devient alors son conseiller. Il réfléchit et se propose de former le Conseil du
Marécage. En cet univers où on subit la loi des dents tranchantes ou des griffes acérées,
qu’importe le nombre ! La mission de Camomille s’avère longue et délicate.
Ouaouaron n’est pas heureux, cependant. Il ne jouit pas de sa propre estime.
Il se sent mal dans sa peau, cette enveloppe brune, molle, humide et froide. Le dos
moucheté de taches diffuses, plus foncées, la lèvre supérieure verte, la gorge jaune, les
pattes postérieures marquées de rayures transversales, autant de détails de son anatomie, qui l’irritent ! Il se sent engoncé dans un costume de carnaval. Le tympan, il est bien plus grand que l’œil. C’est pour mieux écouter ses sujettes, mais elles se tiennent
constamment à distance. Ce ne sont pourtant qu’insignifiantes disgrâces. Pourquoi donc
se tourmenter ? Dans son territoire, il est déjà roi, écouté, vénéré, quoique plutôt craint,
lorsque résonne son chant puissant: Or-woum! Brr-rr-rr-oum ! Un taureau dans le
Marécage, pense-t-on. Le gros pataud inspire ainsi une confiance mitigée. Les dames
Grenouille n’osent pas l’approcher, car il raffole de la chair tendre de ses sujettes. Un
coup de langue charnue instantané et souple suffirait. À l’occasion, il ne dédaigne pas la
jeune couleuvre, dont il ne fait qu’une bouchée.
De la mémoire, Ouaouaron en a. Camomille le Sage, son conseiller, lui a parlé à
la suite de ses périples dans les marécages des tropiques, de ses lointains cousins, les
Dendrobates, dont la peau est vivement colorée, tantôt rouge, parsemée de taches noires
sur les pattes, tantôt jaune et noir, une raie jaune entourée de bandes noires le long du
corps et autour de la tête et des membres. Qu’il serait agréable à la vue de ses sujettes, s’il en était ainsi pourvu. D’aucuns ont même des teintes qui brillent lorsqu’ils bondissent.
Quel spectacle ! De quoi les épater, d’autant plus qu’il saute assez haut. Cela ne
manquerait pas d’impressionner. La peau de ces lointains cousins contient de
nombreuses petites glandes qui sécrètent une substance toxique, pouvant être mortelle.
S’il avait une telle peau aux couleurs éclatantes, cela ferait passer à tout gros goujat
l’envie de le manger tout crû. Point ne serait besoin de s’entourer de gardes du corps
pour aller pique-niquer. La protection de la vie privée serait plus facile à assurer.
Pourquoi donc la nature ne l’a-t-elle pas doté d’une peau pourvue de poisons violents ?
Même si violents qu’ils entraîneraient une mort rapide à celui qui l’ingurgiterait. Et qu’il
lui faudrait un grand gosier pour l’enfourner, tant il est gros ? Ce serait un repas
gargantuesque, quoique funeste pour l’affamé ! Il serait étouffé par sa proie.
Le soleil descend sur l’horizon. Des reflets rougeoyants se dessinent à la surface
de l’onde qui bruit. Une brise tiède court. En cet après-midi sur le déclin, soudain, des
cris déchirent l’air. Ils proviennent d’une hutte située près des rives de l’étang. Acculée
au fond de sa demeure, une ratte défend avec l’énergie du désespoir sa progéniture
contre une intruse qui cherche à prendre possession de son logis. Précipitamment, sort de la hutte une ratte pourchassée par une adversaire plus corpulente qui, de ses pattes, lui agrippe le flanc, puis, de ses incisives tranchantes, lui saisit la nuque. Serrant les
mâchoires, elle la secoue brutalement. Sans lâcher prise, elle l’entraîne en eau profonde.
Ameutées par les cris de détresse, d’autres assaillantes attaquent un rat âgé, qui se défend avec tant d’acharnement qu’elles reculent. Ensanglanté, les flancs lacérés, la fourrure en mue déchirée, il résiste. L’eau est teintée de sang. L’une des rattes, celle qui tenait, de ses mâchoires enserrées, la nuque de sa rivale, refait surface. Le vieux rat réussit à grimper dans la hutte familiale, suivi par sa compagne. A l’aide de leurs griffes et leurs dents, ils ont écarté les assaillantes, qui voulaient s’emparer de leur logis, et ainsi
protégé leur progéniture. La nuque broyée, le corps de la ratte pourchassée flotte. La
guerre de territoire en a fait une victime.
Ouaouaron est d’abord demeuré froid et impassible, mais, dès que le combat
s’aggrave et se fait de plus en plus proche de lui, il est aussi saisi de frayeur, mais il se
garde de rejoindre le peuple déjà caché au plus profond du Marécage. De son poste
d’observation, Hyla, de sa voix fluette, l’encourage à demeurer en place. L’affrontement
entre les rats terminé, les grenouilles remontent à la surface. Elles en ont été quitte pour
la peur. Ouf ! On respire dans le Marécage. Hyla descend alors du bouleau, d’où elle
avait observé les péripéties et exhorté Ouaouaron.
Continuellement, la gent grenouille est côtoyée par les rats dans le Marécage.
Eux ne se soucient guère de la promiscuité des grenouilles. Ils nagent avec une grande
aisance, tant en surface qu’en plongée. Nonchalamment, ils avancent, la tête hors de
l’eau, fendant l’onde, propulsés par les pattes de derrière, guidés par la queue, le
gouvernail en poupe. Ils vaquent à leurs occupations, à la tombée de la nuit, quoique, par
temps gris, ils s’affairent le jour, se déplaçant par-ci, se sustentant par-là. Ils se
nourrissent surtout de végétaux, nénuphars, laîches, quenouilles, scirpes, flèches d’eau,
roseaux creux, aromatiques, d’une quantité d’animaux, mollusques, barbotes, petites
tortues et, à l’occasion, d’une grenouille. Ils vivent en famille dans une hutte, qu’ils
construisent, vers le début de l’automne, à l’aide de quenouilles ou de scirpes à grandes
feuilles, liés avec de la boue. Ils y accèdent par des quais, des canaux d’alimentation,
ainsi que par des couloirs aménagés, en plein milieu du territoire de la gent grenouille.
Très querelleurs, ils se battent avec acharnement, défendant fermement leur espace vital
contre leurs congénères. Quant à Ouaouaron, il regarde passer ces bestioles couvertes de poils, qui, au cours de leurs baignades, relèvent nonchalamment une longue queue
écailleuse hors de l’eau. Surprises, elles plongent promptement, en la faisant claquer.
Alors que de tels rats se tenaient parmi les roseaux, les pattes dans l’eau, Ouaouaron a pu observer tout à loisir leur face, de petits yeux perçants, des narines et de minuscules
oreilles dissimulées dans une épaisse fourrure. Trapus, couverts d’une fourrure d’un
duvet soyeux et touffu, hérissée de longs jars mêlés au poil fin, ils traînent une longue
queue aplatie, portant des franges de poils hérissés. Dans sa peau glabre, Ouaouaron est
désolé, car il ne peut pas couvrir sa nudité, envelopper sa difformité et la cacher à
jamais. Sa présence dans le Marécage indiffère les rats. Ils ignorent tout de lui et s’en
moquent éperdument. Pour eux, seul le respect de l’espace vital compte. Ils assurent leur
descendance dans le choix et pratiquent la monogamie. Mâles et femelles possèdent des
glandes anales qui, le rut durant, augmentent de grosseur et sécrètent un liquide dont
l’odeur rappelle celle du musc. Quand vient la saison, les dames s’emparent des endroits
les plus propices à l’aménagement d’un gîte, près d’une souche, d’une bille ou d’une
touffe de saules, en bordure de la végétation émergente, près des eaux profondes. Elles
forcent alors dames et sieurs en trop à chercher abri, nourriture, conjoint, ailleurs. La
richesse ne contentant que ceux qui ont les dents longues, que reste-t-il aux autres ? Peu
importe les conditions, à se multiplier. La loi du nombre, à son tour, opprime, mais
démocratiquement. Hyla n’est pas sans le savoir, encore faudrait-il qu’il y ait de la
nourriture en quantité suffisante… Et coasse encore, petite grenouille, dans le marécage de la vie. À la nuit tombante, un cri déchirant se répercute le long des collines au profil érodé, entourant les lacs, telle une plainte ensorcelante au sein d’une nature grandiose, sauvage, encore mystérieuse. Dans les marais, dès le crépuscule, à une note grave,
mélancolique, une seconde répond, puis une troisième; à l’unisson, progressivement, le
chœur du Marécage résonne à des lieues et, jusqu’à l’aube…