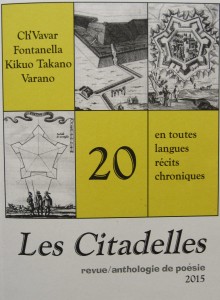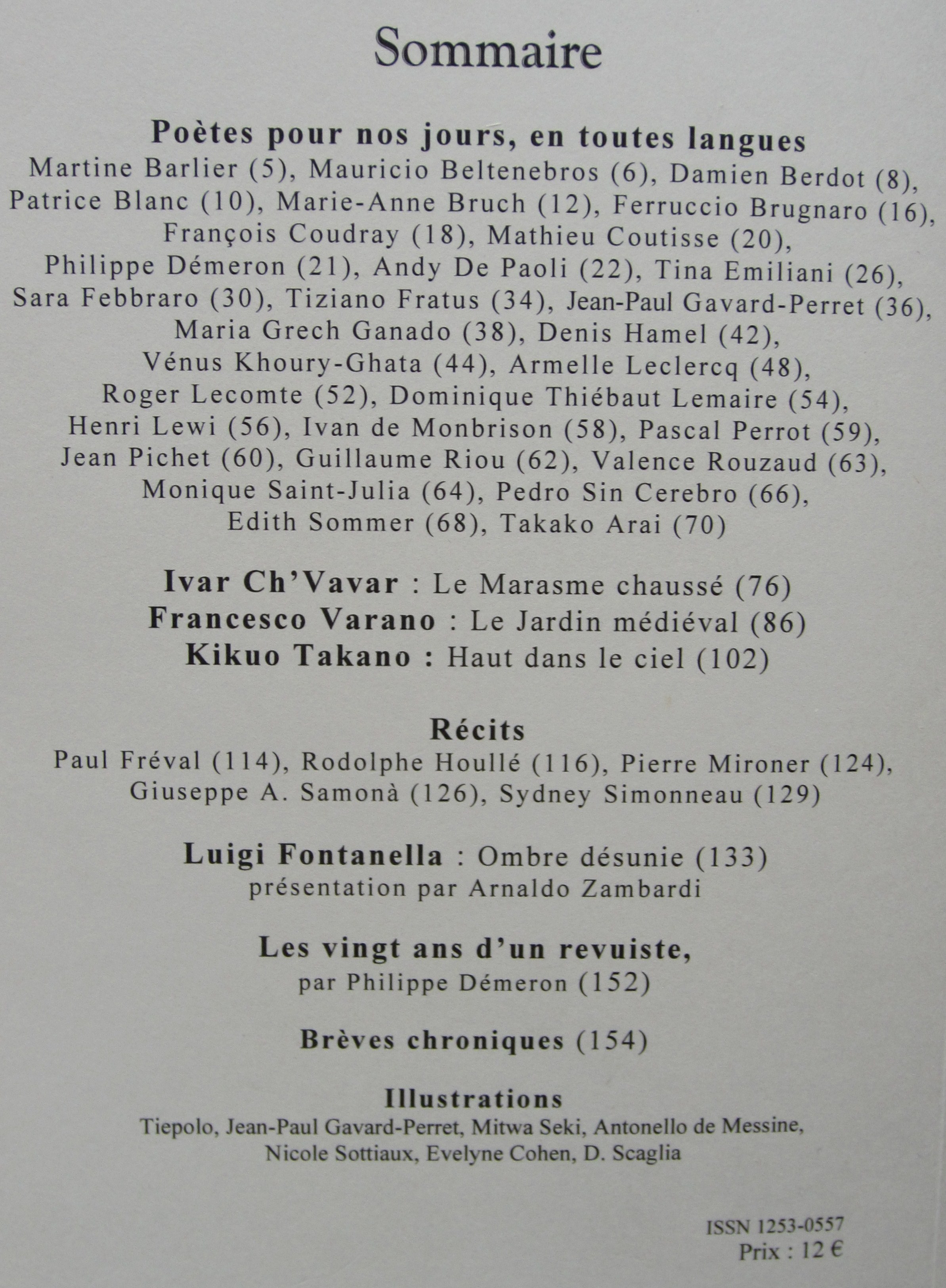Maurice Denis au temps des Nabis.
Exposition du 22 mai au 10 juillet 2015 à la Galerie Malingue (24 avenue Matignon, 75008 Paris).
En 1889 Maurice Denis – il a alors 19 ans – écrit dans son Journal : « Je crois que l’Art doit sanctifier la nature ; je crois que la vision sans l’Esprit est vaine ; et que c’est la mission de l’Esthète d’ériger les choses belles en immarcescibles icônes ».
Les tableaux que présente la Galerie Malingue, issus de collections particulières, sont exécutés, à quelques exceptions près, entre 1889 et 1895. Et ils datent tous d’avant 1900. Ils ont la fraicheur, la spontanéité des œuvres de jeunesse. La forte emprise du Mouvement nabi s’y fait sentir.
Les premières œuvres sont d’inspiration religieuse. Le jeune homme, qui assiste à des cérémonies dans l’église obscure de Saint-Germain, capte des effets de lumière et d’ombre, des silhouettes de femmes en prière, un prêtre à l’autel. Le « Christ vert » (21 cm sur 15 cm), malgré son petit format, provoque un choc visuel. Ses couleurs fortes qui semblent sortir du tube, vert, rouge et jaune, anticipent l’Expressionnisme allemand et le Fauvisme. Il faut ne pas oublier que cette même année 1889 voit Gauguin peindre « Le Christ jaune ». Les couleurs, chez les Nabis, ont une portée symbolique. A la violence de la Crucifixion s’oppose la douceur de la « Visitation en bleu », un bleu donné en camaïeu dans une peinture décorative et néanmoins chargée de spiritualité. Il y a, dans l’exposition, deux représentations de saint Sébastien et leur différence de traitement montre bien la richesse de l’imagination du peintre. En 1893 c’est le martyre du saint qui est montré dans une image qui rappelle une miniature médiévale, tandis que, l’année suivante, Sébastien est représenté de façon énigmatique, nu à mi-corps et lumineux, comme veillé par deux figures de femmes recueillies.
Comme ce sera toujours le cas, la vie personnelle de Denis trouve son écho dans ses œuvres. Il écrira plus tard : « La première période de ma peinture, c’est l’amour, l’émerveillement devant la beauté de la Femme ». L’amour, c’est Marthe, la fiancée, puis l’épouse. Jeune fille, puis jeune femme, aux traits enfantins et délicats, contemplée avec fascination. Nue, habillée. Démultipliée. Mélancolique. Ensommeillée. Doucement maternelle. Sur fonds d’arbres ou de mer. Dans des intérieurs qui évoquent les tableaux de la Renaissance italienne. Les couleurs de ces tableaux heureux sont claires et mates. Marthe est parfois représentée avec un double, sa sœur, la musicienne Eva. C’est Eva qui lui présente, l’année du mariage, l’enfant espéré, comme elle accompagne Marthe dans la « Maternité à la pomme » (souvenir d’Eve ?), dans une douceur verte et blanc rosé, première maternité avant tant d’autres et souvenir de tant de Vierges à l’Enfant.
Cette Marthe bien vivante est aussi l’objet de la rêverie du peintre qui l’idéalise jusqu’à en faire une image symbolique. Il écrit : « Il faudrait l’attirer hors du temps et de l’espace » et, plus loin, « qu’elle passe dans la vie comme les saintes dans les légendes, nimbée, surnaturelle, différente ». Deux beaux tableaux, de format plus ample, « Le Verger des Vierges sages » et « La Princesse dans la Tour », évoquent des images d’attente où Marthe dans son vêtement d’épouse attend le chevalier qui viendra la rejoindre après des épreuves et luttes au long du chemin sinueux de la vie. Le verger, hortus conclusus, peuplé de femmes disposées en arabesque, la tour, évoquant plutôt une fresque siennoise du Trecento, et à chaque fois une merveilleuse image de la femme aimée.
Dans les années qui suivent 1895, Denis reçoit la commande par le marchand d’art Siegfried Bing, grand amateur d’estampes japonaises et qui vient d’ouvrir un magasin dédié à l’Art Nouveau, de panneaux décoratifs destinés à orner sa chambre à coucher et il en réalise d’autres pour son propre intérieur Ce sont des frises, exécutées dans des tons pastel, celle de la Farandole, plus fantastique, celle des deux Marronniers, du Rosier blanc et des Chevreaux, douce et sereine, où l’on voit toute la maestria dans la composition dont témoigneront les fresques à venir.
Il serait injuste d’oublier la présence de la nature bretonne dans cette première période liée au Mouvement nabi. Denis aime cette mer changeante et cette terre de légendes et de foi. On voit dans l’exposition des versions reprises plus tardivement de « Régates à Perros-Guirec », avec la mer vermiculée par le jeu du soleil et les silhouettes noires des femmes en coiffe et, si différent parce que fantastique, « Ils virent des fées débarquer sur les plages », tableau totalement onirique, inspiré par « Le Voyage d’Urien » de Gide et d’une grande beauté plastique.
Pour accompagner l’exposition qui a les qualités et l’intérêt d’une exposition muséale, on peut se procurer le catalogue. Il est nourri de remarques éclairantes et de précieuses citations extraites du Journal du peintre.
Annie Birga

![unnamed[3]](http://www.ouvroir.info/libresfeuillets/wp-content/uploads/2015/05/unnamed3.jpg)